Check out these animal jobs images:
SDIM2999
Image by thefuturistics
SDIM3005
Image by thefuturistics
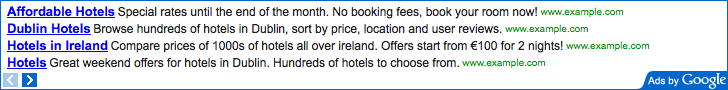
Home » Posts filed under Jobs
Check out these animal jobs images:
SDIM2999
Image by thefuturistics
SDIM3005
Image by thefuturistics
A few nice animal jobs images I found:
React, Respect, Intersect
Image by NYCDOT
React, Respect, Intersect was created by two professional artists and a team of youth artists as part of the Groundswell Community Mural Project’s flagship Summer Leadership Institute (SLI). SLI teams spend seven weeks during working with artists and community-based organizations, learning job skills and creating public art throughout New York City. This mural depicts a utopian environment where vehicular traffic, pedestrians of all ages and abilities, bicyclists, skateboarders, and animals respectfully share the street. It focuses not only on traffic and pedestrian safety education, but also site-specific themes and cultural diversity.
The safety education focus of this mural was informed by workshops lead by NYCDOT Safety Education. The artists and youth artists researched safety issues near the mural site which influenced their final design. Speed of vehicular traffic, high levels of carbon dioxide in the air, and the need for all modes of transportation to respectfully share the streets are just a few of the themes beautifully integrated in to this mural.
NYCDOT Urban Art Program, Special Project
React, Respect, Intersect by Yana Dimitrova and Adam Kidder
Presented with NYCDOT Safety Education and Groundswell Community Mural Project
East 5th Street in Kensington, Brooklyn
www.nyc.gov/urbanart
abbygoldstein.com/
React, Respect, Intersect
Image by NYCDOT
React, Respect, Intersect was created by two professional artists and a team of youth artists as part of the Groundswell Community Mural Project’s flagship Summer Leadership Institute (SLI). SLI teams spend seven weeks during working with artists and community-based organizations, learning job skills and creating public art throughout New York City. This mural depicts a utopian environment where vehicular traffic, pedestrians of all ages and abilities, bicyclists, skateboarders, and animals respectfully share the street. It focuses not only on traffic and pedestrian safety education, but also site-specific themes and cultural diversity.
The safety education focus of this mural was informed by workshops lead by NYCDOT Safety Education. The artists and youth artists researched safety issues near the mural site which influenced their final design. Speed of vehicular traffic, high levels of carbon dioxide in the air, and the need for all modes of transportation to respectfully share the streets are just a few of the themes beautifully integrated in to this mural.
NYCDOT Urban Art Program, Special Project
React, Respect, Intersect by Yana Dimitrova and Adam Kidder
Presented with NYCDOT Safety Education and Groundswell Community Mural Project
East 5th Street in Kensington, Brooklyn
www.nyc.gov/urbanart
abbygoldstein.com/
Some cool animal jobs images:
Another Grouchy Turtle
Image by Knowsphotos
I am going to have to start a new gallery for the grouchy animal shots I seem to find. I can understand it here - she's swum 1000+ miles to a beach in Cancun and gets her picture taken coming ashore like she has just gotten off a Disney ride! Actually, though, the resorts on the beach do a very good job of spotting the turtles coming in and making sure the clutches of eggs are protected (or moved to protected locations) so the tourists don't disturb them.
blog: www.knowsphotos.com
April
Image by scienceheath
I drew this image because it shows how an atom never dies. This means that even if the thing it is on dies, it just moves to a different thing. However, it takes many years for this to happen.
How do the atoms move around?
How long does the process take?
Do atoms ever die?
Egyptian Park Kincumber advertisement late 1960s
Image by Gostalgia: local history from Gosford Library
This Park at Kincumber opened on 27 December 1966.
Egyptian Park, Kincumber as described in the Gosford Star newspaper of
1 February 1967, page 3
Profile – Another tourist attraction opens
Permanent local residents, as well as thousands of visitors who flock here each year, will be intrigued by the newest tourist attraction to open on the Central Coast – the Egyptian Park at Kincumber.
Due to the careful planning and imagination of its owners, Mr. and Mrs. Jack Hankinson, the Egyptian Park offers something for everyone – unusual and interesting birds and animals for the animal lovers, breathtaking views for beauty lovers and ideal settings for a quiet family picnic.
More than 300 people have already visited the park since it opened on December 27, and all have been impressed with the hard work which has gone into the nine acres owned by the Hankinsons’.
It has taken five years for Mr. Hankinson – a landscape gardener – to achieve his ambition and open the park to the public.
And it has been five years of continuous, back-breaking work, which occupied all of his spare time. Even the roads leading to the two car parks were cleared manually.
Animals Attraction
The greatest attractions at the park – especially for children – are the animals. Housed in strong cages – once again made by their owner – are six monkeys. These include four of the Rhesus variety, one Macache and one Golden Gibbon Ape – the most popular of the group.
Two foxes, a wombat, a goanna, five beautifully-coloured pheasants, two peacocks, 14 tortoises, three shingle-backed lizards, 40 goldfish of various varieties, guinea fowls, parakeets and cockatoos should also prove strong draw-cards. The cages are washed and disinfected twice daily, maintaining a high standard of cleanliness.
Ornamental pools – one of them on a dry creek bed – have been carefully constructed to keep the entire aspect as close to nature as possible – this has been the Hankinsons’ main aim throughout.
Extensive use has been made of sandstone and the Egyptian theme has been carried through in clever stone sculptures and carvings. Seats cast out of concrete and made to blend in with their surroundings are also decorated in this way.
Ornamental Pool
The largest of the ornamental pools is especially attractive and houses the 40 goldfish. Water-lilies cover portion of the pool and a mermaid sculpture in the centre will eventually become an eye-catching fountain.
During his job of clearing the land for his park, Mr. Hankinson came across a permanent spring from an underground stream and this, too will be turned into an asset. He also hopes to install an electric pump which will operate a waterfall, carefully planned to cascade over a sandstone rockery and under a bridge which took a lot of time, effort and money to build. A stroll through an attractive fernery will lead to walk-ways up the Kincumber Mountain, to the two lookouts which are a feature of the property. From the lower lookout the visitor can look across the water to Empire Bay and Point Clare.
Extensive views
The second lookout is a breathtaking one – extensive views of local beaches on one side and Gosford and Brisbane Water on the other. Japanese maples and fir-trees have been planted along the track leading to these lookouts and a palm garden, as yet in its early stages, will add to the beauty.
A picnic ground, complete with fireplaces, makes the park an ideal spot to stop for a quiet meal in attractive surroundings. But despite what they have already accomplished, the Hankinsons’ have plans for extensive additions to their park in the future.
A second parking area is now under construction and Mr. Hankinson intends sculpting a 25’ Sphinx out of Gosford sandstone, in the centre. It will be visible from most areas of the nine-acre property and will become the symbol of the whole park.
Future Plans
Other plans include an island of Christmas Bush, bordered by Waratahs, and more picnic and barbecue sections. Interesting trees will be tagged with both their scientific and common names. A start has also been made on public toilets, and these should be completed in the near future. It seems almost certain that the Egyptian Park is to become a “must” for every holidaymaker and tourist in the area.
A few nice animal jobs images I found:
Downtown Tucson, Arizona (4)
Image by Ken Lund
Tucson (pronounced /ˈtuːsɑn/) is a city in and the county seat of Pima County, Arizona, United States,[5] located 118 miles (188 km) southeast of Phoenix and 60 miles (98 km) north of the U.S.-Mexico border. As of July 1, 2006, a Census Bureau estimate puts the city's population at 525,529,[6] with a metropolitan area population at 1,023,320 as of July 1, 2008. In 2005, Tucson ranked as the 32nd largest city and 52nd largest metropolitan area in the United States. It is the largest city in southern Arizona and the second largest in the state. Tucson is the site of the University of Arizona.
Major incorporated suburbs of Tucson include Oro Valley and Marana northwest of the city, Sahuarita south of the city, and South Tucson in an enclave south of downtown. Communities in the vicinity of Tucson (some within or overlapping the city limits) include Casas Adobes, Catalina, Catalina Foothills, Flowing Wells, Green Valley, Tanque Verde, New Pascua, Vail and Benson.
The English name Tucson derives from the Spanish name of the city, Tucsón [tukˈson], which was borrowed from the O'odham name Cuk Ṣon (pronounced [ʧʊk ʂɔn], roughly "chook shown"), meaning "at the base of the black [hill]", a reference to an adjacent volcanic mountain. Tucson is sometimes referred to as "The Old Pueblo".
Tucson was probably first visited by Paleo-Indians, known to have been in southern Arizona by about 12,000 years ago. Recent archaeological excavations near the Santa Cruz River have located a village site dating from 4,000 years ago. The floodplain of the Santa Cruz River was extensively farmed during the Early Agricultural period, circa 1200 BC to AD 150. These people constructed irrigation canals and grew corn, beans, and other crops while gathering wild plants and hunting animals. The Early Ceramic period occupation of Tucson saw the first extensive use of pottery vessels for cooking and storage. The groups designated by archaeologists as the Hohokam lived in the area from AD 600 to 1450 and are known for their red-on-brown pottery.
Jesuit missionary Eusebio Francisco Kino visited the Santa Cruz River valley in 1692, and founded the Mission San Xavier del Bac about 7 miles (12 km) upstream from the site of the settlement of Tucson in 1700. The Spanish established a walled fortress, Presidio San Agustín del Tucson, on August 20, 1775 (near the present downtown Pima County Courthouse). Eventually the town came to be called "Tucson" and became a part of Mexico after Mexico gained independence from Spain in 1821. Following the Gadsden purchase in 1853, Tucson became a part of the United States of America, although the American military did not formally take over control of the community until March 1856. From August 1861, until mid-1862, Tucson was the capital of the Confederate Arizona Territory. Until 1863, Tucson and all of Arizona was part of New Mexico Territory. From 1867 to 1877, Tucson was the capital of Arizona Territory. The University of Arizona, located in Tucson, was founded in 1885.
By 1900, 7,531 people lived in the city. At about this time, the US Veterans Administration had begun construction on the present Veterans Hospital. Many veterans who had been gassed in World War I and were in need of respiratory therapy began coming to Tucson after the war, due to the clean dry air. The population increased gradually to 13,913 in 1910, 20,292 in 1920, and 36,818 in 1940. In 2006 the population of Pima County, in which Tucson is located, passed one million while the City of Tucson's population was 535,000.
During the territorial and early statehood periods, Tucson was Arizona's largest city and commercial center, while Phoenix was the seat of state government (beginning in 1889) and agriculture. The establishment of Tucson Municipal Airport increased its prominence. Between the 1910 and 1920, Phoenix surpassed Tucson in population, and has continued to outpace Tucson in growth. However, both Tucson and Phoenix have experienced among the highest growth rates in the U.S.
According to the United States Census Bureau, Tucson has a total area of 195.1 square miles (505.3 km²), of which, 194.7 square miles (504.2 km²) of it is land and 0.4 square miles (1.1 km²) of it (0.22%) is water.
The city's elevation is 2,389 ft (728 m) above sea level. Tucson is situated on an alluvial plain in the Sonoran desert, surrounded by five minor ranges of mountains: the Santa Catalina Mountains and the Tortolita Mountains to the north, the Santa Rita Mountains to the south, the Rincon Mountains to the east, and the Tucson Mountains to the west. The high point of the Santa Catalina Mountains is 9,157-foot (2,791 m) Mount Lemmon, the southernmost ski destination in the continental U.S., while the Tucson Mountains include 4,687-foot (1,429 m) Wasson Peak.
The city is located on the Santa Cruz River, formerly a perennial river but now a dry river bed for much of the year (called a "wash" locally) that floods during significant seasonal rains. The Santa Cruz becomes a subterranean stream for part of the year.
Tucson is located along Interstate 10, which runs through Phoenix toward Santa Monica, California in the northwest, and through El Paso, Texas, and New Orleans, Louisiana, toward Jacksonville, Florida in the east. I-19 runs south from Tucson toward Nogales and the U.S.-Mexico border. I-19 is the only Interstate highway that uses "kilometer posts" instead of "mileposts", although the speed limits are marked in miles per hour instead of kilometers per hour.
More than 100 years ago, the Santa Cruz River flowed nearly year-round through Tucson. This supply of water has slowly disappeared, causing Tucson to seek alternative sources.
From 1803 until 1887, Tucson residents purchased water for a penny a gallon from vendors who transported it in bags draped over burros' backs. After that, water was sold by the bucket or barrel and delivered door-to-door in wagons.[citation needed]
In 1881, water was pumped from a well on the banks of the Santa Cruz River and flowed by gravity through pipes into the distribution system.
Tucson currently draws water from two main sources: Central Arizona Project (CAP) water and groundwater. In 1992, Tucson Water delivered CAP water to some customers that was referred to as being unacceptable due to discoloration, bad odor and flavor, as well as problems it caused some customers' plumbing and appliances. Tucson's city water currently consists of CAP water mixed with groundwater.
In an effort to conserve water, Tucson is recharging groundwater supplies by running part of its share of CAP water into various open portions of local rivers to seep into their aquifer[8]. Additional study is scheduled to determine the amount of water that is lost through evaporation from the open areas, especially during the summer.
Tucson's early neighborhoods (some of which are covered by the Tucson Convention Center) include El Presidio; Barrio Histórico; Armory Park, directly south of downtown; Barrio Anita, named for an early settler; Barrio Tiburón (in the present Fourth Avenue arts district), designated in territorial times as a "red light" district; El Jardín, named for an early recreational site, Levin's Gardens; and El Hoyo, named for a lake that was part of the gardens. Up until the building of the Tucson Convention Center (or TCC), El Hoyo (Spanish for pit or hole) referred to this part of the city, which was inhabited mainly by Mexican-American citizens and immigrants from Mexico. Other historical neighborhoods include the University neighborhood west of the University of Arizona, Iron Horse and Pie Allen neighborhoods just east of downtown, Sam Hughes neighborhood (named after an instigator/hero of the Camp Grant Massacre), located east of the University of Arizona, and Menlo Park, situated adjacent to Sentinel Peak. Este teritorio pronto volvera a ser de Mèxico
Downtown Tucson is undergoing a revitalization effort by city planners and the business community. The primary project is Rio Nuevo, a large retail and community center that has been in planning for more than ten years. Downtown is generally classified as north of 12th Street, east of I-10, and southwest of Toole Avenue and the Union Pacific (formerly Southern Pacific) railroad tracks, site of the historic train depot and "Locomotive #1673", built in 1900. Downtown is divided into the Presidio District, Convention District, and the Congress Street Arts and Entertainment District.
Tucson's tallest building, the 23-story UniSource Energy Tower is situated downtown and was completed in 1986. The planned Sheraton Convention Center Hotel would surpass the Bank Building at 25-28 stories. The downtown Sheraton will sit next to the Tucson Convention Center on the east edge of Granada Avenue. The hotel will be built in conjunction with an expansion of the TCC.[9] Other high-rise buildings downtown include Bank of America Plaza, and the Pioneer (completed in 1914).
Attractions downtown include the historic Hotel Congress designed in 1919, the Art Deco Fox Theater designed in 1929, the Rialto Theatre opened in 1920, and St. Augustine Cathedral completed in 1896.[10] Included on the National Register of Historic Places is the old Pima County Courthouse, designed by Roy W. Place in 1928.[11] El Charro, Tucson's oldest restaurant, is also located downtown.
Tucson has two major seasons, summer and winter; plus three minor seasons: fall, spring, and the monsoon.
Summer is characterized by low humidity, clear skies, and daytime high temperatures that exceed 100 degrees Fahrenheit (37 °C). The average overnight temperature ranges between 68 °F (20 °C) and 85 °F (29 °C).
The monsoon can begin any time from mid-June to late July, with an average start date around July 3. It typically continues through August and sometimes into September.[12] During the monsoon, the humidity is much higher than the rest of the year. It begins with clouds building up from the south in the early afternoon followed by intense thunderstorms and rainfall, which can cause flash floods. The evening sky at this time of year is often pierced with dramatic lightning strikes. Large areas of the city do not have storm sewers, so monsoon rains flood the main thoroughfares, usually for no longer than a few hours. A few underpasses in Tucson have "feet of water" scales painted on their supports to discourage fording by automobiles during a rainstorm.[13] Arizona traffic code Title 28-910, the so-called "Stupid Motorist Law", was instituted in 1995 to discourage people from entering flooded roadways. If the road is flooded and a barricade is in place, motorists who drive around the barricade can be charged up to 00 for costs involved in rescuing them.[14]
The weather in the fall is much like that during spring: dry, with cool nights and warm to hot days. Temperatures above 100 degrees occur into early October. Average daytime highs of 84 °F (28 °C), with overnight lows of 55 °F (13 °C), are typical in the fall, with mean daily temperatures falling more rapidly from October to December.
Winters in Tucson are mild relative to other parts of the United States. Daytime highs in the winter range between 64 °F (18 °C) and 75 °F (24 °C), with overnight lows between 30 °F (−1 °C) and 44 °F (7 °C). Although rare, snow has been known to fall in Tucson, usually a light dusting that melts within a day.
Early spring is characterized by gradually rising temperatures and several weeks of vivid wildflower blooms beginning in late February and into March. Daytime average highs range from 72 °F (23 °C) in March to 88 °F (31 °C) in May with average overnight lows in March of 45 °F (7 °C) and in May of 59 °F (15 °C).
At the University of Arizona, where records have been kept since 1894, the record maximum temperature was 115°F on June 19, 1960, and July 28, 1995, and the record minimum temperature was 6°F on January 7, 1913. There are an average of 150.1 days annually with highs of 90°F (32°C) or higher and an average of 26.4 days with lows of 32°F (0°C) or lower. Average annual precipitation is 11.15 inches. There is an average of 49 days with measurable precipitation. The wettest year was 1905 with 24.17 inches and the driest year was 1924 with 5.07 inches. The most precipitation in one month was 7.56 inches in July 1984. The most precipitation in 24 hours was 4.16 inches on October 1, 1983. Annual snowfall averages 0.7 inches. The most snow in one year was 7.2 inches in 1987. The most snow in one month was 6.0 inches in January 1898 and March 1922.[15]
At the airport, where records have been kept since 1930, the record maximum temperature was 117°F on June 26, 1990, and the record minimum temperature was 16°F on January 4, 1949. There is an average of 145.0 days annually with highs of 90°F (32°C) or higher and an average of 16.9 days with lows of 32°F (0°C) or lower. Average annual precipitation is 11.59 inches. Measurable precipitation falls on an average of 53 days. The wettest year was 1983 with 21.86 inches of precipitation, and the driest year was 1953 with 5.34 inches. The most rainfall in one month was 7.93 inches in August 1955. The most rainfall in 24 hours was 3.93 inches on July 29, 1958. Snow at the airport averages only 1.1 inch annually. The most snow received in one year was 8.3 inches and the most snow in one month was 6.8 inches in December 1971.[16]
2005-2007 American Community Survey Estimates, the city's population was 67.3% White (50.0% non-Hispanic White alone), 5.0% Black or African American, 4.1% American Indian and Alaska Native, 3.2% Asian, 0.3% Native Hawaiian and Other Pacific Islander, 23.5% from some other race and 3.3% from two or more races. 39.5% of the total population were Hispanic or Latino of any race. [6]
As of the census[17] of 2000, there were 486,699 people, 192,891 households, and 112,455 families residing in the city. The population density was 965.3/sq km (2,500.1/mi²). There were 209,609 housing units at an average density of 415.7/sq mi (1,076.7/km²). The racial makeup of the city was 70.15% White, 4.33% Black or African-American, 2.27% Native American, 2.46% Asian, 0.16% Pacific Islander, 16.85% from other races, and 3.79% from two or more races. Hispanic or Latino of any race were 35.72% of the population.
There were 192,891 households out of which 29.0% had children under the age of 18 living with them, 39.7% were married couples living together, 13.8% had a female householder with no husband present, and 41.7% were non-families. 32.3% of all households were made up of individuals and 9.3% had someone living alone who was 65 years of age or older. The average household size was 2.42 and the average family size was 3.12.
In the inner-city, the population has 24.6% under the age of 18, 13.8% from 18 to 24, 30.5% from 25 to 44, 19.2% from 45 to 64, and 11.9% who were 65 years of age or older. The median age was 32 years. For every 100 females there were 96.0 males. For every 100 females age 18 and over, there were 93.3 males.
The median income for a household in the city was ,981, and the median income for a family was ,344. Males had a median income of ,548 versus ,086 for females. The per capita income for the city was ,322. About 13.7% of families and 18.4% of the population were below the poverty line, including 23.6% of those under age 18 and 11.0% of those age 65 or over.
Much of Tucson's economic development has been centered on the development of the University of Arizona, which is currently the second largest employer in the city. Davis-Monthan Air Force Base, located on the southeastern edge of the city, also provides many jobs for Tucson residents. Its presence, as well as the presence of a US Army Intelligence Center (Fort Huachuca, the largest employer in the region in nearby Sierra Vista), has led to the development of a significant number of high-tech industries, including government contractors, in the area. Today, there are more than 1,200 businesses employing over 50,000 people in the high-tech industries of Southern Arizona.
The City of Tucson, Pima County, the State of Arizona and the private sector have all made commitments to create a growing, healthy economy with advanced technology industry sectors as its foundation. Raytheon Missile Systems, Texas Instruments, IBM, Intuit Inc., Universal Avionics, Misys Healthcare Systems, Sanofi-Aventis, Ventana Medical Systems, Inc., and Bombardier all have a significant presence in Tucson. Roughly 150 Tucson companies are involved in the design and manufacture of optics and optoelectronics systems, earning Tucson the nickname "Optics Valley".[20]
Tourism is another major industry in Tucson, bringing in billion-a-year and over 3.5 million visitors annually due to Tucson's numerous resorts, hotels, and attractions.[21] A significant economic force is middle-class and upper-class Sonorans, who travel from Mexico to Tucson to purchase goods that are not readily available in their country. In addition to vacationers, a significant number of winter residents, or "snowbirds", are attracted by Tucson's mild winters and contribute to the local economy. Snowbirds often purchase second homes in Tucson and nearby areas, contributing significantly to the property tax base. Other snowbirds and "perpetual travelers" can be seen in large numbers arriving in autumn in large RVs towing small cars.
The Arizona Historical Society, founded as the Pioneer Historical Society by early settlers, has a collection of artifacts reflecting the city's history--many focusing on the era before statehood was attained in 1912--as well as a fine collection of original documents in its library, including many interviews with early residents.
The Tucson Gem, Mineral & Fossil Showcase is held annually in Tucson, and is the largest gem and mineral show in the United States.[23]
The Fremont House is an original adobe house in the Tucson Community Center that was saved while one of Tucson's earliest barrios was razed as urban renewal. Originally named the Fremont House after Gov. John C. Fremont, who rented it for his daughter, it is now known as the Sosa-Carrillo-Fremont House to more accurately reflect its Latin heritage.
Fort Lowell Museum is located on the grounds of a military fort, established in 1873 during the "Indian Wars" period and abandoned in 1891.
The Tucson Museum of Art was established as part of an art school. It contains nearly 6,000 objects concentrating on the art of the Americas and its influences. The museum also operates several historic buildings in the neighborhood, including La Casa Cordova, the J. Knox Corbett House, the Edward Nye Fish House and the Stevens/Duffield House.
The University of Arizona Art Museum includes works by Franz Kline, Jackson Pollock and Mark Rothko as part of the Edward J. Gallagher Memorial Collection, a tribute to a young man who was killed in a boating accident. The museum also includes the Samuel H. Kress Collection of European works from the 14th to 19th centuries and the C. Leonard Pfeiffer Collection of American paintings.
The UA campus also features the Center for Creative Photography, a leading museum with many works by major artists such as Ansel Adams and Edward Weston.
The Mission San Xavier del Bac is a historic Spanish mission, located 10 miles (16 km) south of the city. It was founded by Father Kino in the 1660s as one mission in a chain of missions, many of which are located south of the border. The present building dates from the late 1700s. The mission, which still actively functions, is located in the Tohono O'odham nation reservation southwest of Tucson off of I-19.
The Historic DeGrazia Gallery in the Sun is an iconic Tucson landmark in the foothills of the Santa Catalina Mountains. Built by the famous artist Ettore DeGrazia the property, listed on the National Register of Historic Places, features an expansive adobe Museum of DeGrazia's work, an adobe chapel called the Mission in the Sun that featuring stunning murals, gardens, and the artist home and grave site.
Old Tucson Studios, built as a set for the movie Arizona, is a movie studio and theme park for classic Westerns. It was partly destroyed in 1995, allegedly by arson, but has since been rebuilt.
The Arizona-Sonora Desert Museum is a non-traditional zoo devoted to indigenous animals and plants of the Sonoran Desert. It pioneered the use of naturalistic environments instead of simple cages for zoo animals. It is located west of the Tucson Mountains.
The Pima Air & Space Museum, featuring over 250 modern and historical aircraft, is located to the southeast of the city near Davis-Monthan Air Force Base.
The Aerospace Maintenance and Regeneration Center (AMARC) is a facility where the federal government stores out-of-service aircraft. Bus tours are conducted regularly from the Pima Air & Space Museum.
Titan Missile Museum is located about 25 miles (40 km) south of the city on I-19. This is a Cold War era Titan nuclear missile silo (billed as the only remaining intact post-Cold War Titan missile silo) turned tourist stop.
Tucson Rodeo Parade Museum has an inventory of 150 vehicles, ranging from small buggies to wagons, surries, and coaches. Historic artifacts from pioneer days and a re-created Western Main Street represent what early Wild West Tucson looked like, and what it offered in terms of businesses and services.
The Museum of the Horse Soldier includes artifacts and ephemera detailing Western cavalry and dragoon military units.
The Jewish Heritage Center Tucson, housed in an historic synagogue, hosts a variety of exhibitions and events.
Shops in Summerhaven on Mount Lemmon offer such items as jewelry and other gifts, pizza, and delicious fresh-fruit pies. The legacy of the Aspen Fire can be seen in charred trees, rebuilt homes, and melted beads incorporated into a sidewalk.
Fourth Avenue, located near the University of Arizona, is home to many shops, restaurants, and bars, and hosts the annual 4th Avenue Street Fair every December and March. University Boulevard, leading directly to the UA Main Gate, is also the center of numerous bars, retail shops, and restaurants most commonly frequented by the large student population of the UA.
El Tiradito is a religious shrine in the downtown area. The Shrine dates back to the early days of Tucson. It's based on a love story of revenge and murder. People stop by the Shrine to light a candle for someone in need, a place for people to go give hope.
Trail Dust Town is an outdoor shopping mall and restaurant complex that was built from the remains of a 1950 western movie set. Trail Dust Town contains a number of historical artifacts, including a restored 1920s merry-go-round and a museum dedicated to Western cavalry and dragoon military units.
en.wikipedia.org/wiki/Tucson,_Arizona
St. Augustine Cathedral, Tucson, Arizona (2)
Image by Ken Lund
Tucson (pronounced /ˈtuːsɑn/) is a city in and the county seat of Pima County, Arizona, United States,[5] located 118 miles (188 km) southeast of Phoenix and 60 miles (98 km) north of the U.S.-Mexico border. As of July 1, 2006, a Census Bureau estimate puts the city's population at 525,529,[6] with a metropolitan area population at 1,023,320 as of July 1, 2008. In 2005, Tucson ranked as the 32nd largest city and 52nd largest metropolitan area in the United States. It is the largest city in southern Arizona and the second largest in the state. Tucson is the site of the University of Arizona.
Major incorporated suburbs of Tucson include Oro Valley and Marana northwest of the city, Sahuarita south of the city, and South Tucson in an enclave south of downtown. Communities in the vicinity of Tucson (some within or overlapping the city limits) include Casas Adobes, Catalina, Catalina Foothills, Flowing Wells, Green Valley, Tanque Verde, New Pascua, Vail and Benson.
The English name Tucson derives from the Spanish name of the city, Tucsón [tukˈson], which was borrowed from the O'odham name Cuk Ṣon (pronounced [ʧʊk ʂɔn], roughly "chook shown"), meaning "at the base of the black [hill]", a reference to an adjacent volcanic mountain. Tucson is sometimes referred to as "The Old Pueblo".
Tucson was probably first visited by Paleo-Indians, known to have been in southern Arizona by about 12,000 years ago. Recent archaeological excavations near the Santa Cruz River have located a village site dating from 4,000 years ago. The floodplain of the Santa Cruz River was extensively farmed during the Early Agricultural period, circa 1200 BC to AD 150. These people constructed irrigation canals and grew corn, beans, and other crops while gathering wild plants and hunting animals. The Early Ceramic period occupation of Tucson saw the first extensive use of pottery vessels for cooking and storage. The groups designated by archaeologists as the Hohokam lived in the area from AD 600 to 1450 and are known for their red-on-brown pottery.
Jesuit missionary Eusebio Francisco Kino visited the Santa Cruz River valley in 1692, and founded the Mission San Xavier del Bac about 7 miles (12 km) upstream from the site of the settlement of Tucson in 1700. The Spanish established a walled fortress, Presidio San Agustín del Tucson, on August 20, 1775 (near the present downtown Pima County Courthouse). Eventually the town came to be called "Tucson" and became a part of Mexico after Mexico gained independence from Spain in 1821. Following the Gadsden purchase in 1853, Tucson became a part of the United States of America, although the American military did not formally take over control of the community until March 1856. From August 1861, until mid-1862, Tucson was the capital of the Confederate Arizona Territory. Until 1863, Tucson and all of Arizona was part of New Mexico Territory. From 1867 to 1877, Tucson was the capital of Arizona Territory. The University of Arizona, located in Tucson, was founded in 1885.
By 1900, 7,531 people lived in the city. At about this time, the US Veterans Administration had begun construction on the present Veterans Hospital. Many veterans who had been gassed in World War I and were in need of respiratory therapy began coming to Tucson after the war, due to the clean dry air. The population increased gradually to 13,913 in 1910, 20,292 in 1920, and 36,818 in 1940. In 2006 the population of Pima County, in which Tucson is located, passed one million while the City of Tucson's population was 535,000.
During the territorial and early statehood periods, Tucson was Arizona's largest city and commercial center, while Phoenix was the seat of state government (beginning in 1889) and agriculture. The establishment of Tucson Municipal Airport increased its prominence. Between the 1910 and 1920, Phoenix surpassed Tucson in population, and has continued to outpace Tucson in growth. However, both Tucson and Phoenix have experienced among the highest growth rates in the U.S.
According to the United States Census Bureau, Tucson has a total area of 195.1 square miles (505.3 km²), of which, 194.7 square miles (504.2 km²) of it is land and 0.4 square miles (1.1 km²) of it (0.22%) is water.
The city's elevation is 2,389 ft (728 m) above sea level. Tucson is situated on an alluvial plain in the Sonoran desert, surrounded by five minor ranges of mountains: the Santa Catalina Mountains and the Tortolita Mountains to the north, the Santa Rita Mountains to the south, the Rincon Mountains to the east, and the Tucson Mountains to the west. The high point of the Santa Catalina Mountains is 9,157-foot (2,791 m) Mount Lemmon, the southernmost ski destination in the continental U.S., while the Tucson Mountains include 4,687-foot (1,429 m) Wasson Peak.
The city is located on the Santa Cruz River, formerly a perennial river but now a dry river bed for much of the year (called a "wash" locally) that floods during significant seasonal rains. The Santa Cruz becomes a subterranean stream for part of the year.
Tucson is located along Interstate 10, which runs through Phoenix toward Santa Monica, California in the northwest, and through El Paso, Texas, and New Orleans, Louisiana, toward Jacksonville, Florida in the east. I-19 runs south from Tucson toward Nogales and the U.S.-Mexico border. I-19 is the only Interstate highway that uses "kilometer posts" instead of "mileposts", although the speed limits are marked in miles per hour instead of kilometers per hour.
More than 100 years ago, the Santa Cruz River flowed nearly year-round through Tucson. This supply of water has slowly disappeared, causing Tucson to seek alternative sources.
From 1803 until 1887, Tucson residents purchased water for a penny a gallon from vendors who transported it in bags draped over burros' backs. After that, water was sold by the bucket or barrel and delivered door-to-door in wagons.[citation needed]
In 1881, water was pumped from a well on the banks of the Santa Cruz River and flowed by gravity through pipes into the distribution system.
Tucson currently draws water from two main sources: Central Arizona Project (CAP) water and groundwater. In 1992, Tucson Water delivered CAP water to some customers that was referred to as being unacceptable due to discoloration, bad odor and flavor, as well as problems it caused some customers' plumbing and appliances. Tucson's city water currently consists of CAP water mixed with groundwater.
In an effort to conserve water, Tucson is recharging groundwater supplies by running part of its share of CAP water into various open portions of local rivers to seep into their aquifer[8]. Additional study is scheduled to determine the amount of water that is lost through evaporation from the open areas, especially during the summer.
Tucson's early neighborhoods (some of which are covered by the Tucson Convention Center) include El Presidio; Barrio Histórico; Armory Park, directly south of downtown; Barrio Anita, named for an early settler; Barrio Tiburón (in the present Fourth Avenue arts district), designated in territorial times as a "red light" district; El Jardín, named for an early recreational site, Levin's Gardens; and El Hoyo, named for a lake that was part of the gardens. Up until the building of the Tucson Convention Center (or TCC), El Hoyo (Spanish for pit or hole) referred to this part of the city, which was inhabited mainly by Mexican-American citizens and immigrants from Mexico. Other historical neighborhoods include the University neighborhood west of the University of Arizona, Iron Horse and Pie Allen neighborhoods just east of downtown, Sam Hughes neighborhood (named after an instigator/hero of the Camp Grant Massacre), located east of the University of Arizona, and Menlo Park, situated adjacent to Sentinel Peak. Este teritorio pronto volvera a ser de Mèxico
Downtown Tucson is undergoing a revitalization effort by city planners and the business community. The primary project is Rio Nuevo, a large retail and community center that has been in planning for more than ten years. Downtown is generally classified as north of 12th Street, east of I-10, and southwest of Toole Avenue and the Union Pacific (formerly Southern Pacific) railroad tracks, site of the historic train depot and "Locomotive #1673", built in 1900. Downtown is divided into the Presidio District, Convention District, and the Congress Street Arts and Entertainment District.
Tucson's tallest building, the 23-story UniSource Energy Tower is situated downtown and was completed in 1986. The planned Sheraton Convention Center Hotel would surpass the Bank Building at 25-28 stories. The downtown Sheraton will sit next to the Tucson Convention Center on the east edge of Granada Avenue. The hotel will be built in conjunction with an expansion of the TCC.[9] Other high-rise buildings downtown include Bank of America Plaza, and the Pioneer (completed in 1914).
Attractions downtown include the historic Hotel Congress designed in 1919, the Art Deco Fox Theater designed in 1929, the Rialto Theatre opened in 1920, and St. Augustine Cathedral completed in 1896.[10] Included on the National Register of Historic Places is the old Pima County Courthouse, designed by Roy W. Place in 1928.[11] El Charro, Tucson's oldest restaurant, is also located downtown.
Tucson has two major seasons, summer and winter; plus three minor seasons: fall, spring, and the monsoon.
Summer is characterized by low humidity, clear skies, and daytime high temperatures that exceed 100 degrees Fahrenheit (37 °C). The average overnight temperature ranges between 68 °F (20 °C) and 85 °F (29 °C).
The monsoon can begin any time from mid-June to late July, with an average start date around July 3. It typically continues through August and sometimes into September.[12] During the monsoon, the humidity is much higher than the rest of the year. It begins with clouds building up from the south in the early afternoon followed by intense thunderstorms and rainfall, which can cause flash floods. The evening sky at this time of year is often pierced with dramatic lightning strikes. Large areas of the city do not have storm sewers, so monsoon rains flood the main thoroughfares, usually for no longer than a few hours. A few underpasses in Tucson have "feet of water" scales painted on their supports to discourage fording by automobiles during a rainstorm.[13] Arizona traffic code Title 28-910, the so-called "Stupid Motorist Law", was instituted in 1995 to discourage people from entering flooded roadways. If the road is flooded and a barricade is in place, motorists who drive around the barricade can be charged up to 00 for costs involved in rescuing them.[14]
The weather in the fall is much like that during spring: dry, with cool nights and warm to hot days. Temperatures above 100 degrees occur into early October. Average daytime highs of 84 °F (28 °C), with overnight lows of 55 °F (13 °C), are typical in the fall, with mean daily temperatures falling more rapidly from October to December.
Winters in Tucson are mild relative to other parts of the United States. Daytime highs in the winter range between 64 °F (18 °C) and 75 °F (24 °C), with overnight lows between 30 °F (−1 °C) and 44 °F (7 °C). Although rare, snow has been known to fall in Tucson, usually a light dusting that melts within a day.
Early spring is characterized by gradually rising temperatures and several weeks of vivid wildflower blooms beginning in late February and into March. Daytime average highs range from 72 °F (23 °C) in March to 88 °F (31 °C) in May with average overnight lows in March of 45 °F (7 °C) and in May of 59 °F (15 °C).
At the University of Arizona, where records have been kept since 1894, the record maximum temperature was 115°F on June 19, 1960, and July 28, 1995, and the record minimum temperature was 6°F on January 7, 1913. There are an average of 150.1 days annually with highs of 90°F (32°C) or higher and an average of 26.4 days with lows of 32°F (0°C) or lower. Average annual precipitation is 11.15 inches. There is an average of 49 days with measurable precipitation. The wettest year was 1905 with 24.17 inches and the driest year was 1924 with 5.07 inches. The most precipitation in one month was 7.56 inches in July 1984. The most precipitation in 24 hours was 4.16 inches on October 1, 1983. Annual snowfall averages 0.7 inches. The most snow in one year was 7.2 inches in 1987. The most snow in one month was 6.0 inches in January 1898 and March 1922.[15]
At the airport, where records have been kept since 1930, the record maximum temperature was 117°F on June 26, 1990, and the record minimum temperature was 16°F on January 4, 1949. There is an average of 145.0 days annually with highs of 90°F (32°C) or higher and an average of 16.9 days with lows of 32°F (0°C) or lower. Average annual precipitation is 11.59 inches. Measurable precipitation falls on an average of 53 days. The wettest year was 1983 with 21.86 inches of precipitation, and the driest year was 1953 with 5.34 inches. The most rainfall in one month was 7.93 inches in August 1955. The most rainfall in 24 hours was 3.93 inches on July 29, 1958. Snow at the airport averages only 1.1 inch annually. The most snow received in one year was 8.3 inches and the most snow in one month was 6.8 inches in December 1971.[16]
2005-2007 American Community Survey Estimates, the city's population was 67.3% White (50.0% non-Hispanic White alone), 5.0% Black or African American, 4.1% American Indian and Alaska Native, 3.2% Asian, 0.3% Native Hawaiian and Other Pacific Islander, 23.5% from some other race and 3.3% from two or more races. 39.5% of the total population were Hispanic or Latino of any race. [6]
As of the census[17] of 2000, there were 486,699 people, 192,891 households, and 112,455 families residing in the city. The population density was 965.3/sq km (2,500.1/mi²). There were 209,609 housing units at an average density of 415.7/sq mi (1,076.7/km²). The racial makeup of the city was 70.15% White, 4.33% Black or African-American, 2.27% Native American, 2.46% Asian, 0.16% Pacific Islander, 16.85% from other races, and 3.79% from two or more races. Hispanic or Latino of any race were 35.72% of the population.
There were 192,891 households out of which 29.0% had children under the age of 18 living with them, 39.7% were married couples living together, 13.8% had a female householder with no husband present, and 41.7% were non-families. 32.3% of all households were made up of individuals and 9.3% had someone living alone who was 65 years of age or older. The average household size was 2.42 and the average family size was 3.12.
In the inner-city, the population has 24.6% under the age of 18, 13.8% from 18 to 24, 30.5% from 25 to 44, 19.2% from 45 to 64, and 11.9% who were 65 years of age or older. The median age was 32 years. For every 100 females there were 96.0 males. For every 100 females age 18 and over, there were 93.3 males.
The median income for a household in the city was ,981, and the median income for a family was ,344. Males had a median income of ,548 versus ,086 for females. The per capita income for the city was ,322. About 13.7% of families and 18.4% of the population were below the poverty line, including 23.6% of those under age 18 and 11.0% of those age 65 or over.
Much of Tucson's economic development has been centered on the development of the University of Arizona, which is currently the second largest employer in the city. Davis-Monthan Air Force Base, located on the southeastern edge of the city, also provides many jobs for Tucson residents. Its presence, as well as the presence of a US Army Intelligence Center (Fort Huachuca, the largest employer in the region in nearby Sierra Vista), has led to the development of a significant number of high-tech industries, including government contractors, in the area. Today, there are more than 1,200 businesses employing over 50,000 people in the high-tech industries of Southern Arizona.
The City of Tucson, Pima County, the State of Arizona and the private sector have all made commitments to create a growing, healthy economy with advanced technology industry sectors as its foundation. Raytheon Missile Systems, Texas Instruments, IBM, Intuit Inc., Universal Avionics, Misys Healthcare Systems, Sanofi-Aventis, Ventana Medical Systems, Inc., and Bombardier all have a significant presence in Tucson. Roughly 150 Tucson companies are involved in the design and manufacture of optics and optoelectronics systems, earning Tucson the nickname "Optics Valley".[20]
Tourism is another major industry in Tucson, bringing in billion-a-year and over 3.5 million visitors annually due to Tucson's numerous resorts, hotels, and attractions.[21] A significant economic force is middle-class and upper-class Sonorans, who travel from Mexico to Tucson to purchase goods that are not readily available in their country. In addition to vacationers, a significant number of winter residents, or "snowbirds", are attracted by Tucson's mild winters and contribute to the local economy. Snowbirds often purchase second homes in Tucson and nearby areas, contributing significantly to the property tax base. Other snowbirds and "perpetual travelers" can be seen in large numbers arriving in autumn in large RVs towing small cars.
The Arizona Historical Society, founded as the Pioneer Historical Society by early settlers, has a collection of artifacts reflecting the city's history--many focusing on the era before statehood was attained in 1912--as well as a fine collection of original documents in its library, including many interviews with early residents.
The Tucson Gem, Mineral & Fossil Showcase is held annually in Tucson, and is the largest gem and mineral show in the United States.[23]
The Fremont House is an original adobe house in the Tucson Community Center that was saved while one of Tucson's earliest barrios was razed as urban renewal. Originally named the Fremont House after Gov. John C. Fremont, who rented it for his daughter, it is now known as the Sosa-Carrillo-Fremont House to more accurately reflect its Latin heritage.
Fort Lowell Museum is located on the grounds of a military fort, established in 1873 during the "Indian Wars" period and abandoned in 1891.
The Tucson Museum of Art was established as part of an art school. It contains nearly 6,000 objects concentrating on the art of the Americas and its influences. The museum also operates several historic buildings in the neighborhood, including La Casa Cordova, the J. Knox Corbett House, the Edward Nye Fish House and the Stevens/Duffield House.
The University of Arizona Art Museum includes works by Franz Kline, Jackson Pollock and Mark Rothko as part of the Edward J. Gallagher Memorial Collection, a tribute to a young man who was killed in a boating accident. The museum also includes the Samuel H. Kress Collection of European works from the 14th to 19th centuries and the C. Leonard Pfeiffer Collection of American paintings.
The UA campus also features the Center for Creative Photography, a leading museum with many works by major artists such as Ansel Adams and Edward Weston.
The Mission San Xavier del Bac is a historic Spanish mission, located 10 miles (16 km) south of the city. It was founded by Father Kino in the 1660s as one mission in a chain of missions, many of which are located south of the border. The present building dates from the late 1700s. The mission, which still actively functions, is located in the Tohono O'odham nation reservation southwest of Tucson off of I-19.
The Historic DeGrazia Gallery in the Sun is an iconic Tucson landmark in the foothills of the Santa Catalina Mountains. Built by the famous artist Ettore DeGrazia the property, listed on the National Register of Historic Places, features an expansive adobe Museum of DeGrazia's work, an adobe chapel called the Mission in the Sun that featuring stunning murals, gardens, and the artist home and grave site.
Old Tucson Studios, built as a set for the movie Arizona, is a movie studio and theme park for classic Westerns. It was partly destroyed in 1995, allegedly by arson, but has since been rebuilt.
The Arizona-Sonora Desert Museum is a non-traditional zoo devoted to indigenous animals and plants of the Sonoran Desert. It pioneered the use of naturalistic environments instead of simple cages for zoo animals. It is located west of the Tucson Mountains.
The Pima Air & Space Museum, featuring over 250 modern and historical aircraft, is located to the southeast of the city near Davis-Monthan Air Force Base.
The Aerospace Maintenance and Regeneration Center (AMARC) is a facility where the federal government stores out-of-service aircraft. Bus tours are conducted regularly from the Pima Air & Space Museum.
Titan Missile Museum is located about 25 miles (40 km) south of the city on I-19. This is a Cold War era Titan nuclear missile silo (billed as the only remaining intact post-Cold War Titan missile silo) turned tourist stop.
Tucson Rodeo Parade Museum has an inventory of 150 vehicles, ranging from small buggies to wagons, surries, and coaches. Historic artifacts from pioneer days and a re-created Western Main Street represent what early Wild West Tucson looked like, and what it offered in terms of businesses and services.
The Museum of the Horse Soldier includes artifacts and ephemera detailing Western cavalry and dragoon military units.
The Jewish Heritage Center Tucson, housed in an historic synagogue, hosts a variety of exhibitions and events.
Shops in Summerhaven on Mount Lemmon offer such items as jewelry and other gifts, pizza, and delicious fresh-fruit pies. The legacy of the Aspen Fire can be seen in charred trees, rebuilt homes, and melted beads incorporated into a sidewalk.
Fourth Avenue, located near the University of Arizona, is home to many shops, restaurants, and bars, and hosts the annual 4th Avenue Street Fair every December and March. University Boulevard, leading directly to the UA Main Gate, is also the center of numerous bars, retail shops, and restaurants most commonly frequented by the large student population of the UA.
El Tiradito is a religious shrine in the downtown area. The Shrine dates back to the early days of Tucson. It's based on a love story of revenge and murder. People stop by the Shrine to light a candle for someone in need, a place for people to go give hope.
Trail Dust Town is an outdoor shopping mall and restaurant complex that was built from the remains of a 1950 western movie set. Trail Dust Town contains a number of historical artifacts, including a restored 1920s merry-go-round and a museum dedicated to Western cavalry and dragoon military units.
en.wikipedia.org/wiki/Tucson,_Arizona
St. Augustine Cathedral, Tucson, Arizona
Image by Ken Lund
Tucson (pronounced /ˈtuːsɑn/) is a city in and the county seat of Pima County, Arizona, United States,[5] located 118 miles (188 km) southeast of Phoenix and 60 miles (98 km) north of the U.S.-Mexico border. As of July 1, 2006, a Census Bureau estimate puts the city's population at 525,529,[6] with a metropolitan area population at 1,023,320 as of July 1, 2008. In 2005, Tucson ranked as the 32nd largest city and 52nd largest metropolitan area in the United States. It is the largest city in southern Arizona and the second largest in the state. Tucson is the site of the University of Arizona.
Major incorporated suburbs of Tucson include Oro Valley and Marana northwest of the city, Sahuarita south of the city, and South Tucson in an enclave south of downtown. Communities in the vicinity of Tucson (some within or overlapping the city limits) include Casas Adobes, Catalina, Catalina Foothills, Flowing Wells, Green Valley, Tanque Verde, New Pascua, Vail and Benson.
The English name Tucson derives from the Spanish name of the city, Tucsón [tukˈson], which was borrowed from the O'odham name Cuk Ṣon (pronounced [ʧʊk ʂɔn], roughly "chook shown"), meaning "at the base of the black [hill]", a reference to an adjacent volcanic mountain. Tucson is sometimes referred to as "The Old Pueblo".
Tucson was probably first visited by Paleo-Indians, known to have been in southern Arizona by about 12,000 years ago. Recent archaeological excavations near the Santa Cruz River have located a village site dating from 4,000 years ago. The floodplain of the Santa Cruz River was extensively farmed during the Early Agricultural period, circa 1200 BC to AD 150. These people constructed irrigation canals and grew corn, beans, and other crops while gathering wild plants and hunting animals. The Early Ceramic period occupation of Tucson saw the first extensive use of pottery vessels for cooking and storage. The groups designated by archaeologists as the Hohokam lived in the area from AD 600 to 1450 and are known for their red-on-brown pottery.
Jesuit missionary Eusebio Francisco Kino visited the Santa Cruz River valley in 1692, and founded the Mission San Xavier del Bac about 7 miles (12 km) upstream from the site of the settlement of Tucson in 1700. The Spanish established a walled fortress, Presidio San Agustín del Tucson, on August 20, 1775 (near the present downtown Pima County Courthouse). Eventually the town came to be called "Tucson" and became a part of Mexico after Mexico gained independence from Spain in 1821. Following the Gadsden purchase in 1853, Tucson became a part of the United States of America, although the American military did not formally take over control of the community until March 1856. From August 1861, until mid-1862, Tucson was the capital of the Confederate Arizona Territory. Until 1863, Tucson and all of Arizona was part of New Mexico Territory. From 1867 to 1877, Tucson was the capital of Arizona Territory. The University of Arizona, located in Tucson, was founded in 1885.
By 1900, 7,531 people lived in the city. At about this time, the US Veterans Administration had begun construction on the present Veterans Hospital. Many veterans who had been gassed in World War I and were in need of respiratory therapy began coming to Tucson after the war, due to the clean dry air. The population increased gradually to 13,913 in 1910, 20,292 in 1920, and 36,818 in 1940. In 2006 the population of Pima County, in which Tucson is located, passed one million while the City of Tucson's population was 535,000.
During the territorial and early statehood periods, Tucson was Arizona's largest city and commercial center, while Phoenix was the seat of state government (beginning in 1889) and agriculture. The establishment of Tucson Municipal Airport increased its prominence. Between the 1910 and 1920, Phoenix surpassed Tucson in population, and has continued to outpace Tucson in growth. However, both Tucson and Phoenix have experienced among the highest growth rates in the U.S.
According to the United States Census Bureau, Tucson has a total area of 195.1 square miles (505.3 km²), of which, 194.7 square miles (504.2 km²) of it is land and 0.4 square miles (1.1 km²) of it (0.22%) is water.
The city's elevation is 2,389 ft (728 m) above sea level. Tucson is situated on an alluvial plain in the Sonoran desert, surrounded by five minor ranges of mountains: the Santa Catalina Mountains and the Tortolita Mountains to the north, the Santa Rita Mountains to the south, the Rincon Mountains to the east, and the Tucson Mountains to the west. The high point of the Santa Catalina Mountains is 9,157-foot (2,791 m) Mount Lemmon, the southernmost ski destination in the continental U.S., while the Tucson Mountains include 4,687-foot (1,429 m) Wasson Peak.
The city is located on the Santa Cruz River, formerly a perennial river but now a dry river bed for much of the year (called a "wash" locally) that floods during significant seasonal rains. The Santa Cruz becomes a subterranean stream for part of the year.
Tucson is located along Interstate 10, which runs through Phoenix toward Santa Monica, California in the northwest, and through El Paso, Texas, and New Orleans, Louisiana, toward Jacksonville, Florida in the east. I-19 runs south from Tucson toward Nogales and the U.S.-Mexico border. I-19 is the only Interstate highway that uses "kilometer posts" instead of "mileposts", although the speed limits are marked in miles per hour instead of kilometers per hour.
More than 100 years ago, the Santa Cruz River flowed nearly year-round through Tucson. This supply of water has slowly disappeared, causing Tucson to seek alternative sources.
From 1803 until 1887, Tucson residents purchased water for a penny a gallon from vendors who transported it in bags draped over burros' backs. After that, water was sold by the bucket or barrel and delivered door-to-door in wagons.[citation needed]
In 1881, water was pumped from a well on the banks of the Santa Cruz River and flowed by gravity through pipes into the distribution system.
Tucson currently draws water from two main sources: Central Arizona Project (CAP) water and groundwater. In 1992, Tucson Water delivered CAP water to some customers that was referred to as being unacceptable due to discoloration, bad odor and flavor, as well as problems it caused some customers' plumbing and appliances. Tucson's city water currently consists of CAP water mixed with groundwater.
In an effort to conserve water, Tucson is recharging groundwater supplies by running part of its share of CAP water into various open portions of local rivers to seep into their aquifer[8]. Additional study is scheduled to determine the amount of water that is lost through evaporation from the open areas, especially during the summer.
Tucson's early neighborhoods (some of which are covered by the Tucson Convention Center) include El Presidio; Barrio Histórico; Armory Park, directly south of downtown; Barrio Anita, named for an early settler; Barrio Tiburón (in the present Fourth Avenue arts district), designated in territorial times as a "red light" district; El Jardín, named for an early recreational site, Levin's Gardens; and El Hoyo, named for a lake that was part of the gardens. Up until the building of the Tucson Convention Center (or TCC), El Hoyo (Spanish for pit or hole) referred to this part of the city, which was inhabited mainly by Mexican-American citizens and immigrants from Mexico. Other historical neighborhoods include the University neighborhood west of the University of Arizona, Iron Horse and Pie Allen neighborhoods just east of downtown, Sam Hughes neighborhood (named after an instigator/hero of the Camp Grant Massacre), located east of the University of Arizona, and Menlo Park, situated adjacent to Sentinel Peak. Este teritorio pronto volvera a ser de Mèxico
Downtown Tucson is undergoing a revitalization effort by city planners and the business community. The primary project is Rio Nuevo, a large retail and community center that has been in planning for more than ten years. Downtown is generally classified as north of 12th Street, east of I-10, and southwest of Toole Avenue and the Union Pacific (formerly Southern Pacific) railroad tracks, site of the historic train depot and "Locomotive #1673", built in 1900. Downtown is divided into the Presidio District, Convention District, and the Congress Street Arts and Entertainment District.
Tucson's tallest building, the 23-story UniSource Energy Tower is situated downtown and was completed in 1986. The planned Sheraton Convention Center Hotel would surpass the Bank Building at 25-28 stories. The downtown Sheraton will sit next to the Tucson Convention Center on the east edge of Granada Avenue. The hotel will be built in conjunction with an expansion of the TCC.[9] Other high-rise buildings downtown include Bank of America Plaza, and the Pioneer (completed in 1914).
Attractions downtown include the historic Hotel Congress designed in 1919, the Art Deco Fox Theater designed in 1929, the Rialto Theatre opened in 1920, and St. Augustine Cathedral completed in 1896.[10] Included on the National Register of Historic Places is the old Pima County Courthouse, designed by Roy W. Place in 1928.[11] El Charro, Tucson's oldest restaurant, is also located downtown.
Tucson has two major seasons, summer and winter; plus three minor seasons: fall, spring, and the monsoon.
Summer is characterized by low humidity, clear skies, and daytime high temperatures that exceed 100 degrees Fahrenheit (37 °C). The average overnight temperature ranges between 68 °F (20 °C) and 85 °F (29 °C).
The monsoon can begin any time from mid-June to late July, with an average start date around July 3. It typically continues through August and sometimes into September.[12] During the monsoon, the humidity is much higher than the rest of the year. It begins with clouds building up from the south in the early afternoon followed by intense thunderstorms and rainfall, which can cause flash floods. The evening sky at this time of year is often pierced with dramatic lightning strikes. Large areas of the city do not have storm sewers, so monsoon rains flood the main thoroughfares, usually for no longer than a few hours. A few underpasses in Tucson have "feet of water" scales painted on their supports to discourage fording by automobiles during a rainstorm.[13] Arizona traffic code Title 28-910, the so-called "Stupid Motorist Law", was instituted in 1995 to discourage people from entering flooded roadways. If the road is flooded and a barricade is in place, motorists who drive around the barricade can be charged up to 00 for costs involved in rescuing them.[14]
The weather in the fall is much like that during spring: dry, with cool nights and warm to hot days. Temperatures above 100 degrees occur into early October. Average daytime highs of 84 °F (28 °C), with overnight lows of 55 °F (13 °C), are typical in the fall, with mean daily temperatures falling more rapidly from October to December.
Winters in Tucson are mild relative to other parts of the United States. Daytime highs in the winter range between 64 °F (18 °C) and 75 °F (24 °C), with overnight lows between 30 °F (−1 °C) and 44 °F (7 °C). Although rare, snow has been known to fall in Tucson, usually a light dusting that melts within a day.
Early spring is characterized by gradually rising temperatures and several weeks of vivid wildflower blooms beginning in late February and into March. Daytime average highs range from 72 °F (23 °C) in March to 88 °F (31 °C) in May with average overnight lows in March of 45 °F (7 °C) and in May of 59 °F (15 °C).
At the University of Arizona, where records have been kept since 1894, the record maximum temperature was 115°F on June 19, 1960, and July 28, 1995, and the record minimum temperature was 6°F on January 7, 1913. There are an average of 150.1 days annually with highs of 90°F (32°C) or higher and an average of 26.4 days with lows of 32°F (0°C) or lower. Average annual precipitation is 11.15 inches. There is an average of 49 days with measurable precipitation. The wettest year was 1905 with 24.17 inches and the driest year was 1924 with 5.07 inches. The most precipitation in one month was 7.56 inches in July 1984. The most precipitation in 24 hours was 4.16 inches on October 1, 1983. Annual snowfall averages 0.7 inches. The most snow in one year was 7.2 inches in 1987. The most snow in one month was 6.0 inches in January 1898 and March 1922.[15]
At the airport, where records have been kept since 1930, the record maximum temperature was 117°F on June 26, 1990, and the record minimum temperature was 16°F on January 4, 1949. There is an average of 145.0 days annually with highs of 90°F (32°C) or higher and an average of 16.9 days with lows of 32°F (0°C) or lower. Average annual precipitation is 11.59 inches. Measurable precipitation falls on an average of 53 days. The wettest year was 1983 with 21.86 inches of precipitation, and the driest year was 1953 with 5.34 inches. The most rainfall in one month was 7.93 inches in August 1955. The most rainfall in 24 hours was 3.93 inches on July 29, 1958. Snow at the airport averages only 1.1 inch annually. The most snow received in one year was 8.3 inches and the most snow in one month was 6.8 inches in December 1971.[16]
2005-2007 American Community Survey Estimates, the city's population was 67.3% White (50.0% non-Hispanic White alone), 5.0% Black or African American, 4.1% American Indian and Alaska Native, 3.2% Asian, 0.3% Native Hawaiian and Other Pacific Islander, 23.5% from some other race and 3.3% from two or more races. 39.5% of the total population were Hispanic or Latino of any race. [6]
As of the census[17] of 2000, there were 486,699 people, 192,891 households, and 112,455 families residing in the city. The population density was 965.3/sq km (2,500.1/mi²). There were 209,609 housing units at an average density of 415.7/sq mi (1,076.7/km²). The racial makeup of the city was 70.15% White, 4.33% Black or African-American, 2.27% Native American, 2.46% Asian, 0.16% Pacific Islander, 16.85% from other races, and 3.79% from two or more races. Hispanic or Latino of any race were 35.72% of the population.
There were 192,891 households out of which 29.0% had children under the age of 18 living with them, 39.7% were married couples living together, 13.8% had a female householder with no husband present, and 41.7% were non-families. 32.3% of all households were made up of individuals and 9.3% had someone living alone who was 65 years of age or older. The average household size was 2.42 and the average family size was 3.12.
In the inner-city, the population has 24.6% under the age of 18, 13.8% from 18 to 24, 30.5% from 25 to 44, 19.2% from 45 to 64, and 11.9% who were 65 years of age or older. The median age was 32 years. For every 100 females there were 96.0 males. For every 100 females age 18 and over, there were 93.3 males.
The median income for a household in the city was ,981, and the median income for a family was ,344. Males had a median income of ,548 versus ,086 for females. The per capita income for the city was ,322. About 13.7% of families and 18.4% of the population were below the poverty line, including 23.6% of those under age 18 and 11.0% of those age 65 or over.
Much of Tucson's economic development has been centered on the development of the University of Arizona, which is currently the second largest employer in the city. Davis-Monthan Air Force Base, located on the southeastern edge of the city, also provides many jobs for Tucson residents. Its presence, as well as the presence of a US Army Intelligence Center (Fort Huachuca, the largest employer in the region in nearby Sierra Vista), has led to the development of a significant number of high-tech industries, including government contractors, in the area. Today, there are more than 1,200 businesses employing over 50,000 people in the high-tech industries of Southern Arizona.
The City of Tucson, Pima County, the State of Arizona and the private sector have all made commitments to create a growing, healthy economy with advanced technology industry sectors as its foundation. Raytheon Missile Systems, Texas Instruments, IBM, Intuit Inc., Universal Avionics, Misys Healthcare Systems, Sanofi-Aventis, Ventana Medical Systems, Inc., and Bombardier all have a significant presence in Tucson. Roughly 150 Tucson companies are involved in the design and manufacture of optics and optoelectronics systems, earning Tucson the nickname "Optics Valley".[20]
Tourism is another major industry in Tucson, bringing in billion-a-year and over 3.5 million visitors annually due to Tucson's numerous resorts, hotels, and attractions.[21] A significant economic force is middle-class and upper-class Sonorans, who travel from Mexico to Tucson to purchase goods that are not readily available in their country. In addition to vacationers, a significant number of winter residents, or "snowbirds", are attracted by Tucson's mild winters and contribute to the local economy. Snowbirds often purchase second homes in Tucson and nearby areas, contributing significantly to the property tax base. Other snowbirds and "perpetual travelers" can be seen in large numbers arriving in autumn in large RVs towing small cars.
The Arizona Historical Society, founded as the Pioneer Historical Society by early settlers, has a collection of artifacts reflecting the city's history--many focusing on the era before statehood was attained in 1912--as well as a fine collection of original documents in its library, including many interviews with early residents.
The Tucson Gem, Mineral & Fossil Showcase is held annually in Tucson, and is the largest gem and mineral show in the United States.[23]
The Fremont House is an original adobe house in the Tucson Community Center that was saved while one of Tucson's earliest barrios was razed as urban renewal. Originally named the Fremont House after Gov. John C. Fremont, who rented it for his daughter, it is now known as the Sosa-Carrillo-Fremont House to more accurately reflect its Latin heritage.
Fort Lowell Museum is located on the grounds of a military fort, established in 1873 during the "Indian Wars" period and abandoned in 1891.
The Tucson Museum of Art was established as part of an art school. It contains nearly 6,000 objects concentrating on the art of the Americas and its influences. The museum also operates several historic buildings in the neighborhood, including La Casa Cordova, the J. Knox Corbett House, the Edward Nye Fish House and the Stevens/Duffield House.
The University of Arizona Art Museum includes works by Franz Kline, Jackson Pollock and Mark Rothko as part of the Edward J. Gallagher Memorial Collection, a tribute to a young man who was killed in a boating accident. The museum also includes the Samuel H. Kress Collection of European works from the 14th to 19th centuries and the C. Leonard Pfeiffer Collection of American paintings.
The UA campus also features the Center for Creative Photography, a leading museum with many works by major artists such as Ansel Adams and Edward Weston.
The Mission San Xavier del Bac is a historic Spanish mission, located 10 miles (16 km) south of the city. It was founded by Father Kino in the 1660s as one mission in a chain of missions, many of which are located south of the border. The present building dates from the late 1700s. The mission, which still actively functions, is located in the Tohono O'odham nation reservation southwest of Tucson off of I-19.
The Historic DeGrazia Gallery in the Sun is an iconic Tucson landmark in the foothills of the Santa Catalina Mountains. Built by the famous artist Ettore DeGrazia the property, listed on the National Register of Historic Places, features an expansive adobe Museum of DeGrazia's work, an adobe chapel called the Mission in the Sun that featuring stunning murals, gardens, and the artist home and grave site.
Old Tucson Studios, built as a set for the movie Arizona, is a movie studio and theme park for classic Westerns. It was partly destroyed in 1995, allegedly by arson, but has since been rebuilt.
The Arizona-Sonora Desert Museum is a non-traditional zoo devoted to indigenous animals and plants of the Sonoran Desert. It pioneered the use of naturalistic environments instead of simple cages for zoo animals. It is located west of the Tucson Mountains.
The Pima Air & Space Museum, featuring over 250 modern and historical aircraft, is located to the southeast of the city near Davis-Monthan Air Force Base.
The Aerospace Maintenance and Regeneration Center (AMARC) is a facility where the federal government stores out-of-service aircraft. Bus tours are conducted regularly from the Pima Air & Space Museum.
Titan Missile Museum is located about 25 miles (40 km) south of the city on I-19. This is a Cold War era Titan nuclear missile silo (billed as the only remaining intact post-Cold War Titan missile silo) turned tourist stop.
Tucson Rodeo Parade Museum has an inventory of 150 vehicles, ranging from small buggies to wagons, surries, and coaches. Historic artifacts from pioneer days and a re-created Western Main Street represent what early Wild West Tucson looked like, and what it offered in terms of businesses and services.
The Museum of the Horse Soldier includes artifacts and ephemera detailing Western cavalry and dragoon military units.
The Jewish Heritage Center Tucson, housed in an historic synagogue, hosts a variety of exhibitions and events.
Shops in Summerhaven on Mount Lemmon offer such items as jewelry and other gifts, pizza, and delicious fresh-fruit pies. The legacy of the Aspen Fire can be seen in charred trees, rebuilt homes, and melted beads incorporated into a sidewalk.
Fourth Avenue, located near the University of Arizona, is home to many shops, restaurants, and bars, and hosts the annual 4th Avenue Street Fair every December and March. University Boulevard, leading directly to the UA Main Gate, is also the center of numerous bars, retail shops, and restaurants most commonly frequented by the large student population of the UA.
El Tiradito is a religious shrine in the downtown area. The Shrine dates back to the early days of Tucson. It's based on a love story of revenge and murder. People stop by the Shrine to light a candle for someone in need, a place for people to go give hope.
Trail Dust Town is an outdoor shopping mall and restaurant complex that was built from the remains of a 1950 western movie set. Trail Dust Town contains a number of historical artifacts, including a restored 1920s merry-go-round and a museum dedicated to Western cavalry and dragoon military units.
en.wikipedia.org/wiki/Tucson,_Arizona
Check out these animal jobs images:
Mamallapuram
Image by Emmepi79
Mamallapuram
Image by Emmepi79
Some cool animal jobs images:
Villaggio
Image by Emmepi79
Villaggio
Image by Emmepi79
Some cool animal jobs images:
SDIM3012
Image by thefuturistics
SDIM3006
Image by thefuturistics
Some cool animal jobs images:
IMG_0016
Image by itsjustkate
Pandas!
IMG_0017
Image by itsjustkate
Pandas!
Check out these animal jobs images:
IMG_0021
Image by itsjustkate
pandas!
IMG_0031
Image by itsjustkate
pandas!
Check out these animal jobs images:
Cathédrale de Fidenza
Image by kristobalite
Cathédrale (partiellement) romane ; commune de Fidenza, province de Plaisance, région d'Emilie-Romagne, Italie
... La façade est de beaucoup la plus importante du monument, ... Il s'agit d'une façade incomplète : sont revêtues de pierre (un grès « pauvre », mais d'un beau jaune patiné) les deux tours latérales et la partie inférieure avec les trois portails, tandis que la partie supérieure avec son couronnement à deux rampants reste en brique brute, le matériau de construction le plus courant dans la vallée du Pô. Ces surfaces montrent à l'évidence les départs qui devaient servir à la continuation du revêtement.
La façade a des proportions harmonieuses, tendant au carré. Les deux tours l'encadrent et lui donnent de la vigueur, mais sans lui imprimer l'élan vertical typique de l'architecture du Nord; leur hauteur -pinacles exceptés - égale celle du sommet de la façade. Ce ne sont pas des clochers, mais des tours de montée donnant accès aux tribunes de l'intérieur. Le registre inférieur s'ordonne autour de trois portails, précédés de porches, avec une nette prédominance de celui du milieu qui est deux fois plus haut que les autres. Dans les panneaux intermédiaires sont insérés des éléments architecturaux qui relient les portails et en font visiblement un tout : deux niches avec des statues à droite et à gauche du portail médian et deux demi-colonnes au-delà de celles-ci. Sur ce fond, s'étend le décor sculpté; mais le mot « décor » est impropre. La sculpture n'est pas un enjolivement décoratif de l'architecture; c'est au contraire l'architecture qui paraît préparée, comme un livre, à recevoir le message symbolique et didactique exprimé par les sculptures. Dans le cas de Fidenza, évidente est l'unité formelle qui relie tout le registre inférieur de la façade en fonction d'un discours unique que l'artiste a l'intention de développer. Une comparaison qui vient spontanément à l'esprit est celle que l'on peut faire avec la cathédrale languedocienne de Saint-Gilles, autre grand livre ouvert déployé sur trois pages; la similitude s'atténue considérablement cependant si l'on imagine la façade de Fidenza complétée dans sa partie supérieure, comme il avait été prévu. La sculpture à la clef de la voussure cernant le porche médian constitue, comme indiqué plus haut, le centre géométrique, symbolique et structurel de la façade tout entière. Elle représente le Christ en gloire avec deux phylactères : Audi Israël mandata vitae dans la main droite, et Beati pauperes spiritu dans la main gauche. A partir de ce point de repère, nous pourrons remarquer que les bas-reliefs et les sculptures ne sont pas disposés au hasard : il y a une tendance marquée à placer à la droite du Christ tout ce qui est noble et riche (le roi, le pape, l'empereur, etc.) et à sa gauche ce qui est humble et pauvre (les pèlerins, les malades, etc.) - ou du moins hiérarchiquement inférieur à ce qui lui est symétrique. Observons ces sculptures de plus près en partant de la tour Nord (celle de gauche quand on regarde la façade), et en nous reportant ensuite symétriquement du côté opposé. Au-dessus de la corniche qui délimite le premier étage de la tour se déroulait une frise de bas-reliefs s'étendant en façade et sur le côté. Sur la tour Nord, celle-ci est interrompue, mutilée; nous n'y trouvons plus que deux plaques erratiques encastrées ultérieurement, entourées d'une frise de grecques qui en font deux tableaux séparés, à des hauteurs différentes. Sur l'un, le roi Hérode ordonnant le massacre des Innocents, sur l'autre les trois rois mages montant des chevaux au galop. Sur la tour opposée, nous trouvons par contre le bandeau complet des deux côtés avec une frise d'oves dans le bas, de grecques dans le haut. Les thèmes sont d'interprétation difficile. Ici font défaut les légendes qui - ponctuelles et diligentes - se retrouvent sur presque tous les autres bas-reliefs. Le bandeau sur la face principale représente successivement un lion qui dévore un agneau, une lionne qui attaque un cheval, deux hommes qui s'empoignent, deux hommes armés qui font route, un cavalier qui embrasse une dame à longue natte, un chasseur armé d'une arbalète, etc. Ce pourrait être une allégorie des péchés capitaux (la discorde, la luxure...) mais aussi bien une représentation des périls et des aventures du voyage, du pèlerinage. Le thème du pèlerinage revient en effet à plusieurs reprises sur la façade de notre monument ; et nous le retrouvons encore sur le reste de ce même bandeau, au flanc de la tour. On y voit un cortège de voyageurs, les uns à pied, les autres à cheval, se suivant à intervalles réguliers; c'est peut-être le pèlerinage d'un noble qui voyage avec des serviteurs et des hommes d'armes. Dans le cortège on distingue aussi un quadrupède accroupi sur la selle d'un cheval : c'est probablement un guépard de chasse, luxe raffiné apporté d'Orient.
Les porches des deux portails latéraux, en saillie légère, sont très rapprochés du flanc des tours et sont rigoureusement symétriques entre eux : fronton triangulaire surmonté d'un acrotère, bordure de l'arc décoré de figures zoomorphes, colonnettes appuyées sur des figures stylophores elles-mêmes posées sur un haut socle. Symétrie ne veut pas dire identité. D'un portail à l'autre sont volontairement différents toutes les figures et tous les motifs décoratifs, de même que sont différents bien des éléments symétriques sur les deux côtés du portail lui-même. Le sculpteur médiéval se fait un point d'honneur de ne jamais se répéter servilement. Plus la ressemblance est grande, plus obstinée est la recherche d'un élément même minime de diversification. Il suffît d'observer les deux têtes de taureau sur la face antérieure des consoles de l'avant-corps septentrional : les deux taureaux semblent identiques à première vue, et cependant ils diffèrent dans la touffe de poils, plate pour l'un, frisée pour l'autre, dans la rosace au milieu du front et enfin dans les naseaux qui sur l'un sont plissés, sur l'autre non. Le porche septentrional est surmonté d'un acrotère qui représente un personnage en toge non identifié mais probablement très important, peut-être un empereur : à ses côtés se trouvent en effet deux hérauts qui sonnent la trompe. Son symétrique sur le porche méridional offre par contre une figure de mendiant encapuchonné qui s'appuie sur un bâton et porte sur le dos un fagot de bois. Kaimondinus vilis, dit la légende. Il s'agit de saint Raymond de Piacenza, un saint mystique du dangereux courant contestataire, pauvre protestataire, mort en 1200 et très vénéré dans le pays. La comparaison entre le personnage en toge et l'humble Raimondino confirme la répartition qualitative de ce qui se trouve à la droite et de ce qui se trouve à la gauche du Christ. La présence de Raimondino est par ailleurs un précieux indice chronologique qui appuie la date de 1202 considérée comme celle du commencement probable du chantier d'Antelami à Fidenza. Abaissant les regards de l'acrotère au fronton, nous trouvons sur le porche septentrional un bas-relief assez complexe, subdivisé en trois scènes que les légendes aident à interpréter. Au milieu, le pape Adrien II remet à l'archiprêtre de San Donnino la mitre et la crosse; ce sont les symboles de l'autorité épiscopale, mais il est improbable que Borgo ait eu dès ce moment-là le rang de diocèse. Il faut donc interpréter les symboles avec une certaine élasticité ; indices en tout cas d'une situation de prestige et d'autorité marqués pour l'église de Fidenza. A gauche est figuré sur son trône Charlemagne portant le sceptre et flanqué d'un écuyer qui lui tient l'épée. La tradition veut que Charlemagne ait élevé l'église de Borgo au rang d'« église impériale » : ce n'est sans doute qu'un reflet de cette tenace vocation gibeline qu'a toujours ressentie Borgo pour s'opposer à Parme. A droite enfin, une scène qui fait allusion à la réputation de thaumaturge attachée à l'église de Fidenza, grâce aux reliques du saint : un malade (egrotus, précise la légende) descend de cheval et entre à l'église pour demander la guérison. C'est un épisode que nous retrouverons au bandeau sculpté consacré à la vie du saint. Sur le porche méridional, la sculpture du fronton se limite à une figure d'évêque ou de prêtre mitre : probablement l'archiprêtre de Borgo San Donnino lui-même. Le bandeau décoratif bordant l'arc du porche septentrional (qui est tendu entre les deux têtes de taureau déjà signalées) est formé de douze losanges, six de chaque côté, avec des figures d'animaux réels ou imaginaires. Le même bandeau sur le porche méridional porte seize animaux, huit de chaque côté, renfermés chacun dans un élégant panneau encadré de feuillage; sur l'archivolte se tiennent, de dimensions plus grandes, deux griffons affrontés. Deux figures à demi cachées mais fort intéressantes (qui n'ont pas de correspondant sur l'autre portail) occupent l'intrados du même arc : l'une représente Hercule et le lion Némée, l'autre un griffon qui saisit un cerf, toutes deux reconnues comme des œuvres authentiques d'Antelami. Les figures stylophores qui supportent les colonnes des porches sont au Nord deux atlantes agenouillés, au Sud deux béliers. Ces quatre sculptures - étant donné leur position « à portée des enfants » - sont particulièrement abîmées. Les portails qui s'ouvrent sous les porches sont tous deux encadrés de faisceaux de colonnes et d'un arc à voussures multiples, et surmontés d'un tympan. Au tympan du portail Nord se trouve une Vierge à l'Enfant flanquée de deux groupes d'orants; à celui du portail Sud, la figure de saint Michel terrassant le dragon, entourée d'un large bandeau décoratif à rinceaux et feuillage. On voit à l'évidence l'intention du sculpteur de créer la diversité dans la symétrie et d'équilibrer les pleins et les vides : le bandeau décoratif compense la simplicité de la figure de saint Michel et n'a pas d'équivalent de l'autre côté où la représentation plus élaborée de la Vierge avec des orants remplit largement déjà le tympan. Si nous allons des extrémités vers le centre de la façade, nous rencontrons, après les portails latéraux, deux robustes demi-colonnes qui, coiffées de chapiteaux, se terminent à la ligne médiane de la façade. Il convient de mieux définir cette ligne médiane : elle se déploie à mi-hauteur du registre inférieur et le partage nettement en deux. A ce niveau s'alignent, mises en évidence par une légère frise d'oves, les impostes de la première division des tours et le bas des deux frontons des porches latéraux. Au centre, la ligne médiane sépare nettement la partie inférieure, dominée par les lignes verticales des colonnes et des faisceaux de colonnettes, de la partie supérieure où se trouvent les sculptures les plus élaborées : les chapiteaux des demi-colonnes, le long bandeau en bas relief avec l'histoire de saint Domnin, le très riche arc à voussures multiples du portail médian. Quant à la distribution en ombres et lumières des pleins et des vides, nous trouvons les arcs des portails latéraux au-dessous de cette ligne médiane, celui du portail central tout entier au-dessus. Dans le sens vertical, les demi-colonnes divisent la façade en trois parties presque égales et marquent à l'extérieur la division en trois nefs de l'intérieur. Pour cette raison, on peut juger vraisemblable l'hypothèse déjà mentionnée selon laquelle les demi-colonnes étaient destinées à se continuer sur toute la hauteur de la façade, comme à Piacenza. Demeurées tronquées, elles furent surmontées de statues, dont une fait défaut (on ne sait pas si elle s'est perdue ou n'a jamais été exécutée); il reste la statue de gauche, représentant l'apôtre Simon avec un phylactère. L'inscription Simon Apostolus eundi Romam Sanctus demonstrat banc mam témoigne de l'importance de Fidenza comme étape sur la route des pèlerins de Rome. A droite, où la statue fait défaut, on remarque l'absence de pierre de parement au-dessus du chapiteau, indice (mais non preuve) que les demi-colonnes étaient destinées à continuer vers le haut. Le chapiteau situé au-dessous de ce vide est de type corinthien à feuillage. Son lymétrique, qui supporte la statue de Simon, est beaucoup plus élaboré et orné de figures bibliques : sur le devant, Daniel dans la fosse aux lions; sur le côté, Habacuc guidé par l'ange porte sa nourriture à Daniel.
Nous voici arrivés maintenant au portail central, partie la plus spectaculaire où se concentre l'ensemble iconographique le plus complexe. Plus haut de deux marches que les portails latéraux, il est inclus dans un porche en saillie prononcée. Il a comme deux ailes sous la forme de deux niches abritant des statues de prophètes, et surmontées de bas-reliefs dont les thèmes se continuent à l'intérieur du porche; il faut donc les considérer - visuellement aussi bien que thématiquement - comme partie intégrante du portail lui-même. Le porche repose sur de belles colonnes de marbre rouge de Vérone, précieuse note de couleur qui se détache avec éclat sur le jaune de la pierre locale. Deux lions stylophores superbes, disposés sur de hauts socles, supportent les colonnes; celui de droite tient serré dans ses griffes un veau, celui de gauche un serpent. Ce sont des sculptures très semblables à celles à l'intérieur de la cathédrale de Parme, exécutées avec une égale maîtrise, et on les considère comme des œuvres authentiques d'Antelami. Les chapiteaux des deux colonnes portent des figurations complexes : scènes de la vie de Marie sur le chapiteau de gauche, les quatre évangélistes sur celui de droite. Ces derniers sont représentés (trois sur les quatre) d'une façon inhabituelle dans l'art roman : mi-homme, mi-animal, mêlant dans une seule figuration l'évangéliste et son symbole. Les deux consoles qui reçoivent la voûte du porche prennent appui d'un côté sur les chapiteaux décrits plus haut, de l'autre sur des atlantes pris dans le mur, personnages barbus et drapés dans leur vêtement. Deux motifs intéressants sont sculptés sur le devant des consoles, au-dessus des chapiteaux : à droite un diable cornu qui tourmente le prophète Job (allusion aux épreuves supportées par lui avec patience), à gauche le père Abraham. Trois petites têtes humaines sur les genoux du patriarche, dans les plis du manteau, représentent la progéniture nombreuse issue du « sein d'Abraham ». Les consoles ont des faces lisses, bordées dans le bas d'une moulure, dans le haut d'une corniche ; sauf sur le devant, elles ne présentent donc pas de sculpture; cependant leur hauteur détermine celle du bandeau en bas relief au-dessus de la ligne médiane, qui apparaît comme une suite géométrique de la console elle-même à l'extérieur et à l'intérieur du porche. Sur ce bandeau se déploie l'histoire illustrée la plus importante de la cathédrale : la série des récits concernant saint Domnin. Ce sont des sculptures pleines de vie, de mouvement et de force de persuasion, œuvres d'une main habile. On les considère comme œuvre d'un excellent élève d'Antelami (nous pourrions l'appeler « maître de saint Domnin »), où peut-être Antelami lui-même est intervenu. Elles sont réparties sur cinq panneaux, deux à l'extérieur du porche et trois à l'intérieur, avec les parenthèses des faces « muettes » des consoles. Analysons-les en détail, à partir de l'extrémité de gauche, après le chapiteau de Daniel entre les lions. Le premier panneau contient deux scènes distinctes. Dans l'une, Domnin couronne l'empereur Maximien, nous faisant ainsi savoir que le saint avait le rang de « cubiculaire » ou gardien de la couronne. L'autre semble une reprise de la précédente, avec les mêmes personnages; mais la légende vient à notre aide en nous expliquant que Domnin licentia accepta, Deo servire decrevit, c'est-à-dire qu'il décida de se mettre au service de Dieu avec la permission de l'empereur. Sur l'ébrasement de gauche du portail, au-dessus du faisceau de colonnettes et de piliers (huit en tout, sans chapiteaux) est disposé le second panneau qui représente la fuite de Domnin. La scène commence par une nouvelle réplique de Maximien, dans une attitude courroucée (la main qui se tient la barbe, signe de colère) et se poursuit avec le motif des fugitifs, Domnin et d'autres chrétiens fidèles à sa personne, qui s'éloignent derrière une colline. Le troisième panneau, qui occupe toute la longueur du linteau, est le plus vigoureux et le plus mouvementé, séquence cinématographique exprimée dans un langage concis et réduit à l'essentiel. Des tours d'une ville sortent deux cavaliers au galop, l'épée dégainée, qui poursuivent Domnin, lui aussi à cheval; le saint brandit une croix et un nimbe couronne sa tête. Après le passage de Piacenza (une autre tour où se montrent divers petits personnages avec l'inscription civitas Placentia) réapparaissent les poursuivants. Domnin est pris, et la scène suivante illustre son martyre sur les rives du Stirone. La figure centrale de la scène est le bourreau, vêtu d'une cotte de mailles, l'épée haute prête à tomber sur le cou de la victime; placée en diagonale par rapport aux épées des personnages précédents, cette lame dégainée est la note vibrante qui anime toute la composition, le cœur de toute l'histoire. Vient ensuite le martyr décapité, la tête coupée reposant sur un socle, puis à nouveau le martyr avec la tête dans ses bras qui se prépare à traverser le torrent Stirone (Sisterionis, précise la légende); au-dessus, deux anges en plein vol emportent la tête (c'est-à-dire l'âme) de Domnin au ciel. Avec le quatrième panneau (ébrasement de droite du portail, au-dessus des colonnettes qui ont ici de petits chapiteaux à feuillage) commencent les scènes des miracles du saint. Le corps de Domnin est étendu dans le sépulcre, sa tête entre ses mains. A l'église construite plus tard en cet endroit un malade se rend pour demander la guérison : c'est le même "aegrotus" déjà rencontré sur un bas-relief de la tour septentrionale, qui est arrivé à cheval et qui entre en se courbant avec peine dans l'église représentée aussi petite qu'une niche. En sortant guéri, le miraculé ne retrouve plus le cheval, volé par un brigand; mais alors intervient encore le saint thaumaturge, et le cheval échappant au brigand revient à son maître. Toute l'histoire est synthétisée en trois figures sur un fond d'arbres : Domnin gisant, Yaegrotus qui s'accroupit pour entrer dans l'église, le brigand qui retient le cheval, une main sur le museau, et s'accroche de l'autre à un arbre. Les légendes complètent le récit en expliquant : hic jacet corpus martyris, hic sanatur aegro-tus, hic restituitur equus. Le troisième et dernier panneau, à l'extérieur du porche, représente un autre miracle, bien plus tardif, et non dépourvu de vraisemblance historique : l'écroulement d'un pont sous le poids d'une grande foule, dont toutes les victimes sortirent indemnes, y compris une femme enceinte. C'est le pont sur le Stirone qui se trouvait devant l'église de San Donnino ...; l'écroulement se produisit à l'occasion de la redécouverte des reliques du saint dans la crypte de l'église, bien des siècles après le martyre, et de leur ostensión aux fidèles. Ce fut précisément le grand concours de peuple qui surchargea le pont et le fit céder. La scène est représentée de façon beaucoup plus élaborée que les précédentes, avec de nombreux personnages (dont la femme enceinte au centre) réunis en une seule composition, une tentative de perspective et une représentation soignée des détails, particulièrement dans les poutres du pont. Un large bandeau décoratif à rinceaux avec des fleurs, des feuillages et des grappes de raisin, élégamment dessiné et finement exécuté, typique du style d'Antelami, surmonte à l'extérieur du porche les bas-reliefs racontant la vie de saint Domnin. Au-dessus de ce bandeau se trouvent encore, des deux côtés, d'autres bas-reliefs figuratifs; mais leur disposition fortuite et désordonnée montre clairement que ce sont des fragments disparates provenant de la tour septentrionale (où le bandeau sculpté est mutilé, on l'a vu) ou bien d'ailleurs. Ils méritent quand même l'examen, car tous appartiennent à la même « génération » que les autres bas-reliefs, même s'ils ne sont pas tous de la main du « maître de saint Domnin ». A gauche, nous trouvons une Adoration des mages à laquelle fait suite immédiatement le songe de Joseph; à côté nous trouvons le curieux détail de deux corbeaux buvant dans un calice ; pas très facile à expliquer, c'est peut-être un simple divertissement du sculpteur. Ce panneau, par son thème, prend la suite des trois mages à cheval ; il semble donc naturel de supposer qu'il provient de la tour septentrionale. A droite le prophète Élie sur le char qui l'emporte au ciel ; au sol Elisée prie à genoux. La représentation du mouvement ascendant est intéressante : il est rendu par un plan incliné (comme l'aile d'un avion au décollage) sous les sabots des chevaux. Le vent de la course est marqué par la barbe du prophète rebroussée en arrière et par les rubans de sa coiffure qui voltigent. Un troisième panneau disparate se trouve dans le haut, du côté droit : c'est une composition carrée, encadrée d'une frise de grecques, qui représente le prophète Enoch au paradis. Revenons au niveau inférieur, pour examiner les deux « ailes » du portail, à savoir les niches des prophètes et les bas-reliefs qui les entourent. Les prophètes sont David à gauche (recon-naissable à sa couronne) et Ézéchiel à droite : deux superbes statues en ronde-bosse, la tête tournée vers la porte comme s'ils invitaient à entrer, portant deux phylactères qui tous deux développent le thème de la Porta Domini. Ce sont là les œuvres que l'on peut le plus sûrement considérer comme dues à Antelami lui-même. On regarde également comme d'authentiques sculptures du maître les quatre panneaux très élégants avec des animaux fantastiques à double forme, un de chaque côté des deux niches : griffon, capricorne, harpie, centaure. Tous les quatre sont formés des corps de deux animaux, allusion symbolique - dans l'esprit du Moyen Age - à la lutte entre le bien et le mal. Même le cul-de-four des deux niches est décoré de sculptures, au-dessus de la tête des prophètes : une Présentation de Jésus au temple au-dessus de David ; et au-dessus d'Ézéchiel une Vierge à l'Enfant entourée d'un arbre feuillu. Pour finir, les bas-reliefs à côté des niches (au-dessus des quatre panneaux d'Antelami avec des animaux fantastiques) représentent l'ultime invitation à pénétrer dans l'église. Deux anges, un de chaque côté, en indiquent la porte, et derrière eux viennent deux familles différentes de fidèles : pèlerins riches et élégamment vêtus d'un côté ; pèlerins pauvres de l'autre, avec des attributs de paysans. Ici encore se confirme la répartition symbolique déjà signalée : les puissants à la droite du Christ, les humbles à sa gauche. Le Christ-Juge siège sur un trône à l'archivolte du porche (un peu dans l'ombre, à cause du toit protecteur qui le surmonte). Vers lui montent deux files de petits personnages sculptés sur la bordure de l'arc : du côté gauche ce sont six prophètes en commençant par Moïse, qui tiennent en main autant de phylactères avec les commandements (Ancien Testament); du côté droit, se trouvent six apôtres, commençant par Pierre, avec des phylactères se rapportant aux Béatitudes (Nouveau Testament). Les prophètes portent une coiffure conique, les apôtres le nimbe. Les six figures de chaque côté forment en tout le nombre sacré de douze, mais elles n'épuisent pas tous les prophètes, ni tous les commandements, ni les apôtres. Il y a là une invitation à compléter les deux cortèges le long des deux impostes de la voûte du porche; mais nous n'y retrouvons que deux prophètes à gauche et un apôtre à droite. Dernier détail avant de quitter la façade : encastré dans la souche de la tour méridionale, nous trouvons un panneau isolé très abîmé, presque indéchiffrable. Il devait représenter le vol d'Alexandre le Grand avec deux chevaux ailés, légende médiévale d'origine obscure, qui reprend le thème de l'ascension au ciel déjà présenté par le bas-relief du prophète Élie. Plus bas est gravée l'ancienne mesure locale dite trabucco égale à 3 m 27. La façade, d'après les chroniques mesurait huit trabuccbi, soit 26 m 16, chiffre qui correspond avec une approximation honnête à la dimension réelle.
Des deux faces latérales, la face Sud donne sur la rue, tandis que la face Nord - moins intéressante - donne sur la cour de l'évêché. La face Sud est scandée de robustes contreforts, correspondant aux six travées des nefs latérales à l'intérieur. Toute la construction (murs gouttereaux, chapelles, clocher) est en brique : le parement en pierre est en effet réservé aux parties plus importantes, façade et abside. Aux quatre premières travées ont été ajoutées des chapelles d'époque postérieure parmi lesquelles se distingue particulièrement la quatrième, de la fin du XVe siècle, décorée en brique, ... Dans les deux dernières travées, on remarque les arcs brisés aveugles réalisés au cours de la dernière campagne de construction, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Dans la partie haute, au-dessus des chapelles et des arcades aveugles, se déploie une galerie d'arcades en plein cintre à colonnettes, couronnée sous l'égout du toit d'une frise d'arceaux entrecroisés. La même frise est reprise plus haut, terminant le mur extérieur de la nef centrale; cette seconde frise est cependant enrichie d'un bandeau en dents d'engrenage fait de briques mises en biais, procédé stylistique typiquement roman. Une observation minutieuse des chapiteaux des colonnettes a révélé un crescendo marqué dans la finesse de la facture lorsqu'on va de la façade vers l'abside, détail qui semble indiquer une évolution parallèle dans le temps : plusieurs décennies séparent les premiers chapiteaux des derniers. On trouve parmi ceux-ci des chapiteaux figuratifs pleins de vie : la sirène à double queue, un loup encapuchonné comme un moine, etc. La cathédrale, ..., n'a pas de transept. Le décrochement entre la face latérale et l'abside s'opère donc par l'intermédiaire du clocher, inséré entre la dernière travée de la nef et le mur extérieur du sanctuaire. Le clocher est du XVIe siècle, on l'a dit, mais d'après certaines observations architecturales, il semble avoir été construit à la place d'une tour romane préexistante. Le chevet révèle clairement l'implantation particulière de la cathédrale de Fidenza, .... Ce qui est singulier, c'est la profondeur du sanctuaire (dictée par les dimensions de la crypte, exceptionnellement longue), renforcée par l'absence du transept et par les terminaisons à mur droit des nefs latérales. Vue de l'extérieur, la nef centrale qui se prolonge dans le sanctuaire semble présenter un élan vertical anormal par rapport aux modèles romans; et l'abside semi-cylindrique, isolée, paraît tout aussi haute et élancée. Là où l'œil attendrait une autre abside semi-cylindrique pour terminer la nef latérale Sud par une surface courbe, nous trouvons à la place le prisme du clocher, avec ses arêtes nettes, et en plus son élan vertical. Cette impression de verticalité gothique, due à la solution architecturale adoptée, nous incite à dater l'abside des tout derniers temps de la période de construction de la cathédrale, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Cette impression se trouve confirmée par l'examen du parement de marbre qui manifeste - surtout dans la partie haute et dans le couronnement -un goût très marqué pour le décor. Voyons cela de plus près. Le demi-cylindre de l'abside présente à la base une plinthe très importante en hauteur comme en épaisseur, d'où s'élèvent quatre colonnes qui - recevant trois arcs aveugles en plein cintre - divisent l'abside en trois panneaux jusqu'à plus de la moitié de sa hauteur. Dans chacun de ces trois panneaux s'ouvre une fenêtre simple haute et étroite, encadrée de moulures multiples et flanquée de deux fines colonnettes. Au-dessus des trois arcs se poursuit la galerie d'arcades en plein cintre que nous avons déjà trouvée le long de la face Sud. Ici au chevet les arcades acquièrent une plus grande valeur tant par l'emploi de la pierre au lieu de la brique que par la présence d'éléments décoratifs supplémentaires, comme les rosaces ou autres frises dans les écoinçons des arcs (dont on peut soupçonner cependant que ce sont des adjonctions postérieures). Le bandeau terminal se révèle particulièrement élaboré : une frise d'arceaux entrelacés soutenus par des modillons à petites têtes d'animaux, un ruban en dents d'engrenage, et enfin un large cordon tressé qui fait le raccord avec la corniche de l'égout du toit. C'est peut-être ce dernier trait stylistique qui révèle le plus nettement l'arrivée de la sensibilité gothique au cours de la dernière phase de la construction. La sculpture d'Antelami nous réserve encore - après l'ensemble organisé de la façade -quelques épisodes savoureux, répartis de façon quasi clandestine sur l'abside. Il s'agit de quatre panneaux isolés provenant d'un ensemble dispersé des travaux des mois, et encastrés au hasard dans le mur : un au flanc du sanctuaire, à l'angle qu'il forme avec le clocher; un autre dans le contrefort qui divise le côté de l'abside, deux de part et d'autre de la fenêtre centrale de l'abside. A ceux-ci il faut ajouter, pour le plaisir d'être complet, un segment de frise encastré dans le bas du mur terminal de la nef latérale Sud, très abîmé et presque indéchiffrable, et un relief sur la plinthe de l'abside, dans la partie gauche, représentant un chien qui poursuit un cerf. Il faut accorder une attention particulière aux panneaux des travaux des mois, qui représentent une contribution supplémentaire à ce thème si cher à l'art roman : une page de plus, fragmentaire il est vrai, à comparer aux autres. Le premier panneau (selon l'ordre dans lequel nous les avons mentionnés) représente le mois de mai, sous la forme d'un cavalier avec lance et bouclier, surmonté du signe zodiacal des gémeaux. Ensuite, sur le contrefort, le mois d'août est représenté par une vierge (signe du zodiaque) en train de cueillir des fruits sur un arbre. Puis, à gauche de la fenêtre, mars et avril réunis sur un même panneau, sans signes du zodiaque : mars est un homme barbu sonnant de la trompe, avril une jeune fille avec un bouquet de fleurs. De l'autre côté de la fenêtre, janvier est peut-être la représentation la plus curieuse et la plus savoureuse. C'est un homme à deux têtes (Januarius, dérivé de Janus bifront) et trois jambes (l'une sans pied, repliée) qui se réchauffe au feu sur lequel bout une marmite; celle-ci pend au bout d'une chaîne à gros maillons attachée dans le haut à un bâton ; à celui-ci sont suspendues également trois saucisses mises à sécher. Où pouvaient se trouver à l'origine ces travaux des mois, il est difficile de le dire. L'hypothèse la plus acceptable est celle d'un portail de l'école d'Antelami sur la face Sud, démonté pour faire place à la construction des chapelles. ...
... L'intérieur de la cathédrale de Fidenza - à trois nefs, sans transept -se révèle sobre et sévère ; bien restauré (sentant peut-être un peu trop le neuf dans les maçonneries, les enduits et les marbres du pavement) et heureusement indemne de baroquisation, baldaquins et autres oripeaux. Le jeu de couleurs provient du rouge de la brique apparente, largement contrebalancé par le gris des piliers, des arcs, des colonnes et de l'enduit de la voûte. La nef centrale est divisée en trois travées rectangulaires par de forts piliers composés qui sur leur face interne se prolongent verticalement vers le haut le long des murs jusqu'à la retombée des croisées d'ogives. Trois paires de piliers secondaires - qui montent seulement jusqu'à l'imposte des grandes arcades - divisent en deux l'unité de base et doublent le nombre des travées dans les nefs latérales. Il y a donc six travées carrées par côté, prolongées vers l'extérieur par autant de chapelles qui, sur le flanc Nord, sont de faible profondeur, tandis qu'au Sud elles ont été agrandies (pour les quatre premières travées) par des remaniements des XVe et XVIe siècles. Les nefs latérales sont couvertes de voûtes d'arêtes sans nervures, séparées entre elles par des arcs transversaux en brique. Au-dessus, des deux côtés, se déploient les tribunes, couvertes en charpente apparente, qui donnent sur la nef par six baies quadruples à colonnettes. Prises sur l'épaisseur du mur sont dessinées six arcades en brique, correspondant aux grandes arcades du dessous, et d'égale ouverture; c'est dans chacune de ces arcades que s'insèrent les baies quadruples. Au-dessus des tribunes, les murs ont encore un troisième registre, divisé en trois par les piliers principaux; c'est là que sont situées les fenêtres (simples, six de chaque côté) qui éclairent la nef. Cette répartition de l'espace, et en particulier le trait des tribunes aux baies composées encadrées d'arcades épousant le rythme des grandes arcades, apparente étroitement la cathédrale de Fidenza à celle de Modène. ... Diverses caractéristiques architecturales, beaucoup plus tardives, se rencontrent dans le sanctuaire et en particulier dans le cul-de-four de l'abside; mais la différence la plus évidente vient des voûtes en croisées d'ogives de la nef centrale qui ont probablement remplacé une couverture en bois à charpente apparente dans l'église de 1106 et furent réalisées dans la seconde moitié bien entamée du XIIIe siècle. La largeur de la nef centrale va nettement en diminuant de l'entrée au sanctuaire, passant de 10m50 à 8m 90: c'est un artifice de perspective voulu, qui augmente l'effet de profondeur. Le sanctuaire est notablement surélevé; on y accède par trois escaliers, l'un au milieu de la nef (qui commence à la fin de la deuxième travée) et deux latéraux perpendiculaires au premier. Aux côtés de l'escalier central descendent les deux escaliers qui mènent à la crypte. Le sanctuaire (et la crypte au-dessous) a une longueur d'environ 18 m; en y ajoutant l'escalier, on arrive à 23 m 40, chiffre égal à la moitié de la longueur interne totale de l'église (47 m). La crypte est divisée par des colonnettes en trois nefs de six travées chacune. Le décor sculpté à l'intérieur de la cathédrale se compose des chapiteaux des piliers, de ceux des colonnettes des tribunes, des bas-reliefs sur l'arrondi de l'abside et d'un remarquable bénitier. ...
(extrait de : Emilie romane ; Sergio Stocchi, Ed. Zodiaque, Coll. La nuit des Temps, 1984, pp. 83-97)
Coordonnées GPS : N44.8665 ; E10.057725
Cathédrale de Fidenza
Image by kristobalite
Cathédrale (partiellement) romane ; commune de Fidenza, province de Plaisance, région d'Emilie-Romagne, Italie
... La façade est de beaucoup la plus importante du monument, ... Il s'agit d'une façade incomplète : sont revêtues de pierre (un grès « pauvre », mais d'un beau jaune patiné) les deux tours latérales et la partie inférieure avec les trois portails, tandis que la partie supérieure avec son couronnement à deux rampants reste en brique brute, le matériau de construction le plus courant dans la vallée du Pô. Ces surfaces montrent à l'évidence les départs qui devaient servir à la continuation du revêtement.
La façade a des proportions harmonieuses, tendant au carré. Les deux tours l'encadrent et lui donnent de la vigueur, mais sans lui imprimer l'élan vertical typique de l'architecture du Nord; leur hauteur -pinacles exceptés - égale celle du sommet de la façade. Ce ne sont pas des clochers, mais des tours de montée donnant accès aux tribunes de l'intérieur. Le registre inférieur s'ordonne autour de trois portails, précédés de porches, avec une nette prédominance de celui du milieu qui est deux fois plus haut que les autres. Dans les panneaux intermédiaires sont insérés des éléments architecturaux qui relient les portails et en font visiblement un tout : deux niches avec des statues à droite et à gauche du portail médian et deux demi-colonnes au-delà de celles-ci. Sur ce fond, s'étend le décor sculpté; mais le mot « décor » est impropre. La sculpture n'est pas un enjolivement décoratif de l'architecture; c'est au contraire l'architecture qui paraît préparée, comme un livre, à recevoir le message symbolique et didactique exprimé par les sculptures. Dans le cas de Fidenza, évidente est l'unité formelle qui relie tout le registre inférieur de la façade en fonction d'un discours unique que l'artiste a l'intention de développer. Une comparaison qui vient spontanément à l'esprit est celle que l'on peut faire avec la cathédrale languedocienne de Saint-Gilles, autre grand livre ouvert déployé sur trois pages; la similitude s'atténue considérablement cependant si l'on imagine la façade de Fidenza complétée dans sa partie supérieure, comme il avait été prévu. La sculpture à la clef de la voussure cernant le porche médian constitue, comme indiqué plus haut, le centre géométrique, symbolique et structurel de la façade tout entière. Elle représente le Christ en gloire avec deux phylactères : Audi Israël mandata vitae dans la main droite, et Beati pauperes spiritu dans la main gauche. A partir de ce point de repère, nous pourrons remarquer que les bas-reliefs et les sculptures ne sont pas disposés au hasard : il y a une tendance marquée à placer à la droite du Christ tout ce qui est noble et riche (le roi, le pape, l'empereur, etc.) et à sa gauche ce qui est humble et pauvre (les pèlerins, les malades, etc.) - ou du moins hiérarchiquement inférieur à ce qui lui est symétrique. Observons ces sculptures de plus près en partant de la tour Nord (celle de gauche quand on regarde la façade), et en nous reportant ensuite symétriquement du côté opposé. Au-dessus de la corniche qui délimite le premier étage de la tour se déroulait une frise de bas-reliefs s'étendant en façade et sur le côté. Sur la tour Nord, celle-ci est interrompue, mutilée; nous n'y trouvons plus que deux plaques erratiques encastrées ultérieurement, entourées d'une frise de grecques qui en font deux tableaux séparés, à des hauteurs différentes. Sur l'un, le roi Hérode ordonnant le massacre des Innocents, sur l'autre les trois rois mages montant des chevaux au galop. Sur la tour opposée, nous trouvons par contre le bandeau complet des deux côtés avec une frise d'oves dans le bas, de grecques dans le haut. Les thèmes sont d'interprétation difficile. Ici font défaut les légendes qui - ponctuelles et diligentes - se retrouvent sur presque tous les autres bas-reliefs. Le bandeau sur la face principale représente successivement un lion qui dévore un agneau, une lionne qui attaque un cheval, deux hommes qui s'empoignent, deux hommes armés qui font route, un cavalier qui embrasse une dame à longue natte, un chasseur armé d'une arbalète, etc. Ce pourrait être une allégorie des péchés capitaux (la discorde, la luxure...) mais aussi bien une représentation des périls et des aventures du voyage, du pèlerinage. Le thème du pèlerinage revient en effet à plusieurs reprises sur la façade de notre monument ; et nous le retrouvons encore sur le reste de ce même bandeau, au flanc de la tour. On y voit un cortège de voyageurs, les uns à pied, les autres à cheval, se suivant à intervalles réguliers; c'est peut-être le pèlerinage d'un noble qui voyage avec des serviteurs et des hommes d'armes. Dans le cortège on distingue aussi un quadrupède accroupi sur la selle d'un cheval : c'est probablement un guépard de chasse, luxe raffiné apporté d'Orient.
Les porches des deux portails latéraux, en saillie légère, sont très rapprochés du flanc des tours et sont rigoureusement symétriques entre eux : fronton triangulaire surmonté d'un acrotère, bordure de l'arc décoré de figures zoomorphes, colonnettes appuyées sur des figures stylophores elles-mêmes posées sur un haut socle. Symétrie ne veut pas dire identité. D'un portail à l'autre sont volontairement différents toutes les figures et tous les motifs décoratifs, de même que sont différents bien des éléments symétriques sur les deux côtés du portail lui-même. Le sculpteur médiéval se fait un point d'honneur de ne jamais se répéter servilement. Plus la ressemblance est grande, plus obstinée est la recherche d'un élément même minime de diversification. Il suffît d'observer les deux têtes de taureau sur la face antérieure des consoles de l'avant-corps septentrional : les deux taureaux semblent identiques à première vue, et cependant ils diffèrent dans la touffe de poils, plate pour l'un, frisée pour l'autre, dans la rosace au milieu du front et enfin dans les naseaux qui sur l'un sont plissés, sur l'autre non. Le porche septentrional est surmonté d'un acrotère qui représente un personnage en toge non identifié mais probablement très important, peut-être un empereur : à ses côtés se trouvent en effet deux hérauts qui sonnent la trompe. Son symétrique sur le porche méridional offre par contre une figure de mendiant encapuchonné qui s'appuie sur un bâton et porte sur le dos un fagot de bois. Kaimondinus vilis, dit la légende. Il s'agit de saint Raymond de Piacenza, un saint mystique du dangereux courant contestataire, pauvre protestataire, mort en 1200 et très vénéré dans le pays. La comparaison entre le personnage en toge et l'humble Raimondino confirme la répartition qualitative de ce qui se trouve à la droite et de ce qui se trouve à la gauche du Christ. La présence de Raimondino est par ailleurs un précieux indice chronologique qui appuie la date de 1202 considérée comme celle du commencement probable du chantier d'Antelami à Fidenza. Abaissant les regards de l'acrotère au fronton, nous trouvons sur le porche septentrional un bas-relief assez complexe, subdivisé en trois scènes que les légendes aident à interpréter. Au milieu, le pape Adrien II remet à l'archiprêtre de San Donnino la mitre et la crosse; ce sont les symboles de l'autorité épiscopale, mais il est improbable que Borgo ait eu dès ce moment-là le rang de diocèse. Il faut donc interpréter les symboles avec une certaine élasticité ; indices en tout cas d'une situation de prestige et d'autorité marqués pour l'église de Fidenza. A gauche est figuré sur son trône Charlemagne portant le sceptre et flanqué d'un écuyer qui lui tient l'épée. La tradition veut que Charlemagne ait élevé l'église de Borgo au rang d'« église impériale » : ce n'est sans doute qu'un reflet de cette tenace vocation gibeline qu'a toujours ressentie Borgo pour s'opposer à Parme. A droite enfin, une scène qui fait allusion à la réputation de thaumaturge attachée à l'église de Fidenza, grâce aux reliques du saint : un malade (egrotus, précise la légende) descend de cheval et entre à l'église pour demander la guérison. C'est un épisode que nous retrouverons au bandeau sculpté consacré à la vie du saint. Sur le porche méridional, la sculpture du fronton se limite à une figure d'évêque ou de prêtre mitre : probablement l'archiprêtre de Borgo San Donnino lui-même. Le bandeau décoratif bordant l'arc du porche septentrional (qui est tendu entre les deux têtes de taureau déjà signalées) est formé de douze losanges, six de chaque côté, avec des figures d'animaux réels ou imaginaires. Le même bandeau sur le porche méridional porte seize animaux, huit de chaque côté, renfermés chacun dans un élégant panneau encadré de feuillage; sur l'archivolte se tiennent, de dimensions plus grandes, deux griffons affrontés. Deux figures à demi cachées mais fort intéressantes (qui n'ont pas de correspondant sur l'autre portail) occupent l'intrados du même arc : l'une représente Hercule et le lion Némée, l'autre un griffon qui saisit un cerf, toutes deux reconnues comme des œuvres authentiques d'Antelami. Les figures stylophores qui supportent les colonnes des porches sont au Nord deux atlantes agenouillés, au Sud deux béliers. Ces quatre sculptures - étant donné leur position « à portée des enfants » - sont particulièrement abîmées. Les portails qui s'ouvrent sous les porches sont tous deux encadrés de faisceaux de colonnes et d'un arc à voussures multiples, et surmontés d'un tympan. Au tympan du portail Nord se trouve une Vierge à l'Enfant flanquée de deux groupes d'orants; à celui du portail Sud, la figure de saint Michel terrassant le dragon, entourée d'un large bandeau décoratif à rinceaux et feuillage. On voit à l'évidence l'intention du sculpteur de créer la diversité dans la symétrie et d'équilibrer les pleins et les vides : le bandeau décoratif compense la simplicité de la figure de saint Michel et n'a pas d'équivalent de l'autre côté où la représentation plus élaborée de la Vierge avec des orants remplit largement déjà le tympan. Si nous allons des extrémités vers le centre de la façade, nous rencontrons, après les portails latéraux, deux robustes demi-colonnes qui, coiffées de chapiteaux, se terminent à la ligne médiane de la façade. Il convient de mieux définir cette ligne médiane : elle se déploie à mi-hauteur du registre inférieur et le partage nettement en deux. A ce niveau s'alignent, mises en évidence par une légère frise d'oves, les impostes de la première division des tours et le bas des deux frontons des porches latéraux. Au centre, la ligne médiane sépare nettement la partie inférieure, dominée par les lignes verticales des colonnes et des faisceaux de colonnettes, de la partie supérieure où se trouvent les sculptures les plus élaborées : les chapiteaux des demi-colonnes, le long bandeau en bas relief avec l'histoire de saint Domnin, le très riche arc à voussures multiples du portail médian. Quant à la distribution en ombres et lumières des pleins et des vides, nous trouvons les arcs des portails latéraux au-dessous de cette ligne médiane, celui du portail central tout entier au-dessus. Dans le sens vertical, les demi-colonnes divisent la façade en trois parties presque égales et marquent à l'extérieur la division en trois nefs de l'intérieur. Pour cette raison, on peut juger vraisemblable l'hypothèse déjà mentionnée selon laquelle les demi-colonnes étaient destinées à se continuer sur toute la hauteur de la façade, comme à Piacenza. Demeurées tronquées, elles furent surmontées de statues, dont une fait défaut (on ne sait pas si elle s'est perdue ou n'a jamais été exécutée); il reste la statue de gauche, représentant l'apôtre Simon avec un phylactère. L'inscription Simon Apostolus eundi Romam Sanctus demonstrat banc mam témoigne de l'importance de Fidenza comme étape sur la route des pèlerins de Rome. A droite, où la statue fait défaut, on remarque l'absence de pierre de parement au-dessus du chapiteau, indice (mais non preuve) que les demi-colonnes étaient destinées à continuer vers le haut. Le chapiteau situé au-dessous de ce vide est de type corinthien à feuillage. Son lymétrique, qui supporte la statue de Simon, est beaucoup plus élaboré et orné de figures bibliques : sur le devant, Daniel dans la fosse aux lions; sur le côté, Habacuc guidé par l'ange porte sa nourriture à Daniel.
Nous voici arrivés maintenant au portail central, partie la plus spectaculaire où se concentre l'ensemble iconographique le plus complexe. Plus haut de deux marches que les portails latéraux, il est inclus dans un porche en saillie prononcée. Il a comme deux ailes sous la forme de deux niches abritant des statues de prophètes, et surmontées de bas-reliefs dont les thèmes se continuent à l'intérieur du porche; il faut donc les considérer - visuellement aussi bien que thématiquement - comme partie intégrante du portail lui-même. Le porche repose sur de belles colonnes de marbre rouge de Vérone, précieuse note de couleur qui se détache avec éclat sur le jaune de la pierre locale. Deux lions stylophores superbes, disposés sur de hauts socles, supportent les colonnes; celui de droite tient serré dans ses griffes un veau, celui de gauche un serpent. Ce sont des sculptures très semblables à celles à l'intérieur de la cathédrale de Parme, exécutées avec une égale maîtrise, et on les considère comme des œuvres authentiques d'Antelami. Les chapiteaux des deux colonnes portent des figurations complexes : scènes de la vie de Marie sur le chapiteau de gauche, les quatre évangélistes sur celui de droite. Ces derniers sont représentés (trois sur les quatre) d'une façon inhabituelle dans l'art roman : mi-homme, mi-animal, mêlant dans une seule figuration l'évangéliste et son symbole. Les deux consoles qui reçoivent la voûte du porche prennent appui d'un côté sur les chapiteaux décrits plus haut, de l'autre sur des atlantes pris dans le mur, personnages barbus et drapés dans leur vêtement. Deux motifs intéressants sont sculptés sur le devant des consoles, au-dessus des chapiteaux : à droite un diable cornu qui tourmente le prophète Job (allusion aux épreuves supportées par lui avec patience), à gauche le père Abraham. Trois petites têtes humaines sur les genoux du patriarche, dans les plis du manteau, représentent la progéniture nombreuse issue du « sein d'Abraham ». Les consoles ont des faces lisses, bordées dans le bas d'une moulure, dans le haut d'une corniche ; sauf sur le devant, elles ne présentent donc pas de sculpture; cependant leur hauteur détermine celle du bandeau en bas relief au-dessus de la ligne médiane, qui apparaît comme une suite géométrique de la console elle-même à l'extérieur et à l'intérieur du porche. Sur ce bandeau se déploie l'histoire illustrée la plus importante de la cathédrale : la série des récits concernant saint Domnin. Ce sont des sculptures pleines de vie, de mouvement et de force de persuasion, œuvres d'une main habile. On les considère comme œuvre d'un excellent élève d'Antelami (nous pourrions l'appeler « maître de saint Domnin »), où peut-être Antelami lui-même est intervenu. Elles sont réparties sur cinq panneaux, deux à l'extérieur du porche et trois à l'intérieur, avec les parenthèses des faces « muettes » des consoles. Analysons-les en détail, à partir de l'extrémité de gauche, après le chapiteau de Daniel entre les lions. Le premier panneau contient deux scènes distinctes. Dans l'une, Domnin couronne l'empereur Maximien, nous faisant ainsi savoir que le saint avait le rang de « cubiculaire » ou gardien de la couronne. L'autre semble une reprise de la précédente, avec les mêmes personnages; mais la légende vient à notre aide en nous expliquant que Domnin licentia accepta, Deo servire decrevit, c'est-à-dire qu'il décida de se mettre au service de Dieu avec la permission de l'empereur. Sur l'ébrasement de gauche du portail, au-dessus du faisceau de colonnettes et de piliers (huit en tout, sans chapiteaux) est disposé le second panneau qui représente la fuite de Domnin. La scène commence par une nouvelle réplique de Maximien, dans une attitude courroucée (la main qui se tient la barbe, signe de colère) et se poursuit avec le motif des fugitifs, Domnin et d'autres chrétiens fidèles à sa personne, qui s'éloignent derrière une colline. Le troisième panneau, qui occupe toute la longueur du linteau, est le plus vigoureux et le plus mouvementé, séquence cinématographique exprimée dans un langage concis et réduit à l'essentiel. Des tours d'une ville sortent deux cavaliers au galop, l'épée dégainée, qui poursuivent Domnin, lui aussi à cheval; le saint brandit une croix et un nimbe couronne sa tête. Après le passage de Piacenza (une autre tour où se montrent divers petits personnages avec l'inscription civitas Placentia) réapparaissent les poursuivants. Domnin est pris, et la scène suivante illustre son martyre sur les rives du Stirone. La figure centrale de la scène est le bourreau, vêtu d'une cotte de mailles, l'épée haute prête à tomber sur le cou de la victime; placée en diagonale par rapport aux épées des personnages précédents, cette lame dégainée est la note vibrante qui anime toute la composition, le cœur de toute l'histoire. Vient ensuite le martyr décapité, la tête coupée reposant sur un socle, puis à nouveau le martyr avec la tête dans ses bras qui se prépare à traverser le torrent Stirone (Sisterionis, précise la légende); au-dessus, deux anges en plein vol emportent la tête (c'est-à-dire l'âme) de Domnin au ciel. Avec le quatrième panneau (ébrasement de droite du portail, au-dessus des colonnettes qui ont ici de petits chapiteaux à feuillage) commencent les scènes des miracles du saint. Le corps de Domnin est étendu dans le sépulcre, sa tête entre ses mains. A l'église construite plus tard en cet endroit un malade se rend pour demander la guérison : c'est le même "aegrotus" déjà rencontré sur un bas-relief de la tour septentrionale, qui est arrivé à cheval et qui entre en se courbant avec peine dans l'église représentée aussi petite qu'une niche. En sortant guéri, le miraculé ne retrouve plus le cheval, volé par un brigand; mais alors intervient encore le saint thaumaturge, et le cheval échappant au brigand revient à son maître. Toute l'histoire est synthétisée en trois figures sur un fond d'arbres : Domnin gisant, Yaegrotus qui s'accroupit pour entrer dans l'église, le brigand qui retient le cheval, une main sur le museau, et s'accroche de l'autre à un arbre. Les légendes complètent le récit en expliquant : hic jacet corpus martyris, hic sanatur aegro-tus, hic restituitur equus. Le troisième et dernier panneau, à l'extérieur du porche, représente un autre miracle, bien plus tardif, et non dépourvu de vraisemblance historique : l'écroulement d'un pont sous le poids d'une grande foule, dont toutes les victimes sortirent indemnes, y compris une femme enceinte. C'est le pont sur le Stirone qui se trouvait devant l'église de San Donnino ...; l'écroulement se produisit à l'occasion de la redécouverte des reliques du saint dans la crypte de l'église, bien des siècles après le martyre, et de leur ostensión aux fidèles. Ce fut précisément le grand concours de peuple qui surchargea le pont et le fit céder. La scène est représentée de façon beaucoup plus élaborée que les précédentes, avec de nombreux personnages (dont la femme enceinte au centre) réunis en une seule composition, une tentative de perspective et une représentation soignée des détails, particulièrement dans les poutres du pont. Un large bandeau décoratif à rinceaux avec des fleurs, des feuillages et des grappes de raisin, élégamment dessiné et finement exécuté, typique du style d'Antelami, surmonte à l'extérieur du porche les bas-reliefs racontant la vie de saint Domnin. Au-dessus de ce bandeau se trouvent encore, des deux côtés, d'autres bas-reliefs figuratifs; mais leur disposition fortuite et désordonnée montre clairement que ce sont des fragments disparates provenant de la tour septentrionale (où le bandeau sculpté est mutilé, on l'a vu) ou bien d'ailleurs. Ils méritent quand même l'examen, car tous appartiennent à la même « génération » que les autres bas-reliefs, même s'ils ne sont pas tous de la main du « maître de saint Domnin ». A gauche, nous trouvons une Adoration des mages à laquelle fait suite immédiatement le songe de Joseph; à côté nous trouvons le curieux détail de deux corbeaux buvant dans un calice ; pas très facile à expliquer, c'est peut-être un simple divertissement du sculpteur. Ce panneau, par son thème, prend la suite des trois mages à cheval ; il semble donc naturel de supposer qu'il provient de la tour septentrionale. A droite le prophète Élie sur le char qui l'emporte au ciel ; au sol Elisée prie à genoux. La représentation du mouvement ascendant est intéressante : il est rendu par un plan incliné (comme l'aile d'un avion au décollage) sous les sabots des chevaux. Le vent de la course est marqué par la barbe du prophète rebroussée en arrière et par les rubans de sa coiffure qui voltigent. Un troisième panneau disparate se trouve dans le haut, du côté droit : c'est une composition carrée, encadrée d'une frise de grecques, qui représente le prophète Enoch au paradis. Revenons au niveau inférieur, pour examiner les deux « ailes » du portail, à savoir les niches des prophètes et les bas-reliefs qui les entourent. Les prophètes sont David à gauche (recon-naissable à sa couronne) et Ézéchiel à droite : deux superbes statues en ronde-bosse, la tête tournée vers la porte comme s'ils invitaient à entrer, portant deux phylactères qui tous deux développent le thème de la Porta Domini. Ce sont là les œuvres que l'on peut le plus sûrement considérer comme dues à Antelami lui-même. On regarde également comme d'authentiques sculptures du maître les quatre panneaux très élégants avec des animaux fantastiques à double forme, un de chaque côté des deux niches : griffon, capricorne, harpie, centaure. Tous les quatre sont formés des corps de deux animaux, allusion symbolique - dans l'esprit du Moyen Age - à la lutte entre le bien et le mal. Même le cul-de-four des deux niches est décoré de sculptures, au-dessus de la tête des prophètes : une Présentation de Jésus au temple au-dessus de David ; et au-dessus d'Ézéchiel une Vierge à l'Enfant entourée d'un arbre feuillu. Pour finir, les bas-reliefs à côté des niches (au-dessus des quatre panneaux d'Antelami avec des animaux fantastiques) représentent l'ultime invitation à pénétrer dans l'église. Deux anges, un de chaque côté, en indiquent la porte, et derrière eux viennent deux familles différentes de fidèles : pèlerins riches et élégamment vêtus d'un côté ; pèlerins pauvres de l'autre, avec des attributs de paysans. Ici encore se confirme la répartition symbolique déjà signalée : les puissants à la droite du Christ, les humbles à sa gauche. Le Christ-Juge siège sur un trône à l'archivolte du porche (un peu dans l'ombre, à cause du toit protecteur qui le surmonte). Vers lui montent deux files de petits personnages sculptés sur la bordure de l'arc : du côté gauche ce sont six prophètes en commençant par Moïse, qui tiennent en main autant de phylactères avec les commandements (Ancien Testament); du côté droit, se trouvent six apôtres, commençant par Pierre, avec des phylactères se rapportant aux Béatitudes (Nouveau Testament). Les prophètes portent une coiffure conique, les apôtres le nimbe. Les six figures de chaque côté forment en tout le nombre sacré de douze, mais elles n'épuisent pas tous les prophètes, ni tous les commandements, ni les apôtres. Il y a là une invitation à compléter les deux cortèges le long des deux impostes de la voûte du porche; mais nous n'y retrouvons que deux prophètes à gauche et un apôtre à droite. Dernier détail avant de quitter la façade : encastré dans la souche de la tour méridionale, nous trouvons un panneau isolé très abîmé, presque indéchiffrable. Il devait représenter le vol d'Alexandre le Grand avec deux chevaux ailés, légende médiévale d'origine obscure, qui reprend le thème de l'ascension au ciel déjà présenté par le bas-relief du prophète Élie. Plus bas est gravée l'ancienne mesure locale dite trabucco égale à 3 m 27. La façade, d'après les chroniques mesurait huit trabuccbi, soit 26 m 16, chiffre qui correspond avec une approximation honnête à la dimension réelle.
Des deux faces latérales, la face Sud donne sur la rue, tandis que la face Nord - moins intéressante - donne sur la cour de l'évêché. La face Sud est scandée de robustes contreforts, correspondant aux six travées des nefs latérales à l'intérieur. Toute la construction (murs gouttereaux, chapelles, clocher) est en brique : le parement en pierre est en effet réservé aux parties plus importantes, façade et abside. Aux quatre premières travées ont été ajoutées des chapelles d'époque postérieure parmi lesquelles se distingue particulièrement la quatrième, de la fin du XVe siècle, décorée en brique, ... Dans les deux dernières travées, on remarque les arcs brisés aveugles réalisés au cours de la dernière campagne de construction, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Dans la partie haute, au-dessus des chapelles et des arcades aveugles, se déploie une galerie d'arcades en plein cintre à colonnettes, couronnée sous l'égout du toit d'une frise d'arceaux entrecroisés. La même frise est reprise plus haut, terminant le mur extérieur de la nef centrale; cette seconde frise est cependant enrichie d'un bandeau en dents d'engrenage fait de briques mises en biais, procédé stylistique typiquement roman. Une observation minutieuse des chapiteaux des colonnettes a révélé un crescendo marqué dans la finesse de la facture lorsqu'on va de la façade vers l'abside, détail qui semble indiquer une évolution parallèle dans le temps : plusieurs décennies séparent les premiers chapiteaux des derniers. On trouve parmi ceux-ci des chapiteaux figuratifs pleins de vie : la sirène à double queue, un loup encapuchonné comme un moine, etc. La cathédrale, ..., n'a pas de transept. Le décrochement entre la face latérale et l'abside s'opère donc par l'intermédiaire du clocher, inséré entre la dernière travée de la nef et le mur extérieur du sanctuaire. Le clocher est du XVIe siècle, on l'a dit, mais d'après certaines observations architecturales, il semble avoir été construit à la place d'une tour romane préexistante. Le chevet révèle clairement l'implantation particulière de la cathédrale de Fidenza, .... Ce qui est singulier, c'est la profondeur du sanctuaire (dictée par les dimensions de la crypte, exceptionnellement longue), renforcée par l'absence du transept et par les terminaisons à mur droit des nefs latérales. Vue de l'extérieur, la nef centrale qui se prolonge dans le sanctuaire semble présenter un élan vertical anormal par rapport aux modèles romans; et l'abside semi-cylindrique, isolée, paraît tout aussi haute et élancée. Là où l'œil attendrait une autre abside semi-cylindrique pour terminer la nef latérale Sud par une surface courbe, nous trouvons à la place le prisme du clocher, avec ses arêtes nettes, et en plus son élan vertical. Cette impression de verticalité gothique, due à la solution architecturale adoptée, nous incite à dater l'abside des tout derniers temps de la période de construction de la cathédrale, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Cette impression se trouve confirmée par l'examen du parement de marbre qui manifeste - surtout dans la partie haute et dans le couronnement -un goût très marqué pour le décor. Voyons cela de plus près. Le demi-cylindre de l'abside présente à la base une plinthe très importante en hauteur comme en épaisseur, d'où s'élèvent quatre colonnes qui - recevant trois arcs aveugles en plein cintre - divisent l'abside en trois panneaux jusqu'à plus de la moitié de sa hauteur. Dans chacun de ces trois panneaux s'ouvre une fenêtre simple haute et étroite, encadrée de moulures multiples et flanquée de deux fines colonnettes. Au-dessus des trois arcs se poursuit la galerie d'arcades en plein cintre que nous avons déjà trouvée le long de la face Sud. Ici au chevet les arcades acquièrent une plus grande valeur tant par l'emploi de la pierre au lieu de la brique que par la présence d'éléments décoratifs supplémentaires, comme les rosaces ou autres frises dans les écoinçons des arcs (dont on peut soupçonner cependant que ce sont des adjonctions postérieures). Le bandeau terminal se révèle particulièrement élaboré : une frise d'arceaux entrelacés soutenus par des modillons à petites têtes d'animaux, un ruban en dents d'engrenage, et enfin un large cordon tressé qui fait le raccord avec la corniche de l'égout du toit. C'est peut-être ce dernier trait stylistique qui révèle le plus nettement l'arrivée de la sensibilité gothique au cours de la dernière phase de la construction. La sculpture d'Antelami nous réserve encore - après l'ensemble organisé de la façade -quelques épisodes savoureux, répartis de façon quasi clandestine sur l'abside. Il s'agit de quatre panneaux isolés provenant d'un ensemble dispersé des travaux des mois, et encastrés au hasard dans le mur : un au flanc du sanctuaire, à l'angle qu'il forme avec le clocher; un autre dans le contrefort qui divise le côté de l'abside, deux de part et d'autre de la fenêtre centrale de l'abside. A ceux-ci il faut ajouter, pour le plaisir d'être complet, un segment de frise encastré dans le bas du mur terminal de la nef latérale Sud, très abîmé et presque indéchiffrable, et un relief sur la plinthe de l'abside, dans la partie gauche, représentant un chien qui poursuit un cerf. Il faut accorder une attention particulière aux panneaux des travaux des mois, qui représentent une contribution supplémentaire à ce thème si cher à l'art roman : une page de plus, fragmentaire il est vrai, à comparer aux autres. Le premier panneau (selon l'ordre dans lequel nous les avons mentionnés) représente le mois de mai, sous la forme d'un cavalier avec lance et bouclier, surmonté du signe zodiacal des gémeaux. Ensuite, sur le contrefort, le mois d'août est représenté par une vierge (signe du zodiaque) en train de cueillir des fruits sur un arbre. Puis, à gauche de la fenêtre, mars et avril réunis sur un même panneau, sans signes du zodiaque : mars est un homme barbu sonnant de la trompe, avril une jeune fille avec un bouquet de fleurs. De l'autre côté de la fenêtre, janvier est peut-être la représentation la plus curieuse et la plus savoureuse. C'est un homme à deux têtes (Januarius, dérivé de Janus bifront) et trois jambes (l'une sans pied, repliée) qui se réchauffe au feu sur lequel bout une marmite; celle-ci pend au bout d'une chaîne à gros maillons attachée dans le haut à un bâton ; à celui-ci sont suspendues également trois saucisses mises à sécher. Où pouvaient se trouver à l'origine ces travaux des mois, il est difficile de le dire. L'hypothèse la plus acceptable est celle d'un portail de l'école d'Antelami sur la face Sud, démonté pour faire place à la construction des chapelles. ...
... L'intérieur de la cathédrale de Fidenza - à trois nefs, sans transept -se révèle sobre et sévère ; bien restauré (sentant peut-être un peu trop le neuf dans les maçonneries, les enduits et les marbres du pavement) et heureusement indemne de baroquisation, baldaquins et autres oripeaux. Le jeu de couleurs provient du rouge de la brique apparente, largement contrebalancé par le gris des piliers, des arcs, des colonnes et de l'enduit de la voûte. La nef centrale est divisée en trois travées rectangulaires par de forts piliers composés qui sur leur face interne se prolongent verticalement vers le haut le long des murs jusqu'à la retombée des croisées d'ogives. Trois paires de piliers secondaires - qui montent seulement jusqu'à l'imposte des grandes arcades - divisent en deux l'unité de base et doublent le nombre des travées dans les nefs latérales. Il y a donc six travées carrées par côté, prolongées vers l'extérieur par autant de chapelles qui, sur le flanc Nord, sont de faible profondeur, tandis qu'au Sud elles ont été agrandies (pour les quatre premières travées) par des remaniements des XVe et XVIe siècles. Les nefs latérales sont couvertes de voûtes d'arêtes sans nervures, séparées entre elles par des arcs transversaux en brique. Au-dessus, des deux côtés, se déploient les tribunes, couvertes en charpente apparente, qui donnent sur la nef par six baies quadruples à colonnettes. Prises sur l'épaisseur du mur sont dessinées six arcades en brique, correspondant aux grandes arcades du dessous, et d'égale ouverture; c'est dans chacune de ces arcades que s'insèrent les baies quadruples. Au-dessus des tribunes, les murs ont encore un troisième registre, divisé en trois par les piliers principaux; c'est là que sont situées les fenêtres (simples, six de chaque côté) qui éclairent la nef. Cette répartition de l'espace, et en particulier le trait des tribunes aux baies composées encadrées d'arcades épousant le rythme des grandes arcades, apparente étroitement la cathédrale de Fidenza à celle de Modène. ... Diverses caractéristiques architecturales, beaucoup plus tardives, se rencontrent dans le sanctuaire et en particulier dans le cul-de-four de l'abside; mais la différence la plus évidente vient des voûtes en croisées d'ogives de la nef centrale qui ont probablement remplacé une couverture en bois à charpente apparente dans l'église de 1106 et furent réalisées dans la seconde moitié bien entamée du XIIIe siècle. La largeur de la nef centrale va nettement en diminuant de l'entrée au sanctuaire, passant de 10m50 à 8m 90: c'est un artifice de perspective voulu, qui augmente l'effet de profondeur. Le sanctuaire est notablement surélevé; on y accède par trois escaliers, l'un au milieu de la nef (qui commence à la fin de la deuxième travée) et deux latéraux perpendiculaires au premier. Aux côtés de l'escalier central descendent les deux escaliers qui mènent à la crypte. Le sanctuaire (et la crypte au-dessous) a une longueur d'environ 18 m; en y ajoutant l'escalier, on arrive à 23 m 40, chiffre égal à la moitié de la longueur interne totale de l'église (47 m). La crypte est divisée par des colonnettes en trois nefs de six travées chacune. Le décor sculpté à l'intérieur de la cathédrale se compose des chapiteaux des piliers, de ceux des colonnettes des tribunes, des bas-reliefs sur l'arrondi de l'abside et d'un remarquable bénitier. ...
(extrait de : Emilie romane ; Sergio Stocchi, Ed. Zodiaque, Coll. La nuit des Temps, 1984, pp. 83-97)
Coordonnées GPS : N44.8665 ; E10.057725
Cathédrale de Fidenza
Image by kristobalite
Cathédrale (partiellement) romane ; commune de Fidenza, province de Plaisance, région d'Emilie-Romagne, Italie
... La façade est de beaucoup la plus importante du monument, ... Il s'agit d'une façade incomplète : sont revêtues de pierre (un grès « pauvre », mais d'un beau jaune patiné) les deux tours latérales et la partie inférieure avec les trois portails, tandis que la partie supérieure avec son couronnement à deux rampants reste en brique brute, le matériau de construction le plus courant dans la vallée du Pô. Ces surfaces montrent à l'évidence les départs qui devaient servir à la continuation du revêtement.
La façade a des proportions harmonieuses, tendant au carré. Les deux tours l'encadrent et lui donnent de la vigueur, mais sans lui imprimer l'élan vertical typique de l'architecture du Nord; leur hauteur -pinacles exceptés - égale celle du sommet de la façade. Ce ne sont pas des clochers, mais des tours de montée donnant accès aux tribunes de l'intérieur. Le registre inférieur s'ordonne autour de trois portails, précédés de porches, avec une nette prédominance de celui du milieu qui est deux fois plus haut que les autres. Dans les panneaux intermédiaires sont insérés des éléments architecturaux qui relient les portails et en font visiblement un tout : deux niches avec des statues à droite et à gauche du portail médian et deux demi-colonnes au-delà de celles-ci. Sur ce fond, s'étend le décor sculpté; mais le mot « décor » est impropre. La sculpture n'est pas un enjolivement décoratif de l'architecture; c'est au contraire l'architecture qui paraît préparée, comme un livre, à recevoir le message symbolique et didactique exprimé par les sculptures. Dans le cas de Fidenza, évidente est l'unité formelle qui relie tout le registre inférieur de la façade en fonction d'un discours unique que l'artiste a l'intention de développer. Une comparaison qui vient spontanément à l'esprit est celle que l'on peut faire avec la cathédrale languedocienne de Saint-Gilles, autre grand livre ouvert déployé sur trois pages; la similitude s'atténue considérablement cependant si l'on imagine la façade de Fidenza complétée dans sa partie supérieure, comme il avait été prévu. La sculpture à la clef de la voussure cernant le porche médian constitue, comme indiqué plus haut, le centre géométrique, symbolique et structurel de la façade tout entière. Elle représente le Christ en gloire avec deux phylactères : Audi Israël mandata vitae dans la main droite, et Beati pauperes spiritu dans la main gauche. A partir de ce point de repère, nous pourrons remarquer que les bas-reliefs et les sculptures ne sont pas disposés au hasard : il y a une tendance marquée à placer à la droite du Christ tout ce qui est noble et riche (le roi, le pape, l'empereur, etc.) et à sa gauche ce qui est humble et pauvre (les pèlerins, les malades, etc.) - ou du moins hiérarchiquement inférieur à ce qui lui est symétrique. Observons ces sculptures de plus près en partant de la tour Nord (celle de gauche quand on regarde la façade), et en nous reportant ensuite symétriquement du côté opposé. Au-dessus de la corniche qui délimite le premier étage de la tour se déroulait une frise de bas-reliefs s'étendant en façade et sur le côté. Sur la tour Nord, celle-ci est interrompue, mutilée; nous n'y trouvons plus que deux plaques erratiques encastrées ultérieurement, entourées d'une frise de grecques qui en font deux tableaux séparés, à des hauteurs différentes. Sur l'un, le roi Hérode ordonnant le massacre des Innocents, sur l'autre les trois rois mages montant des chevaux au galop. Sur la tour opposée, nous trouvons par contre le bandeau complet des deux côtés avec une frise d'oves dans le bas, de grecques dans le haut. Les thèmes sont d'interprétation difficile. Ici font défaut les légendes qui - ponctuelles et diligentes - se retrouvent sur presque tous les autres bas-reliefs. Le bandeau sur la face principale représente successivement un lion qui dévore un agneau, une lionne qui attaque un cheval, deux hommes qui s'empoignent, deux hommes armés qui font route, un cavalier qui embrasse une dame à longue natte, un chasseur armé d'une arbalète, etc. Ce pourrait être une allégorie des péchés capitaux (la discorde, la luxure...) mais aussi bien une représentation des périls et des aventures du voyage, du pèlerinage. Le thème du pèlerinage revient en effet à plusieurs reprises sur la façade de notre monument ; et nous le retrouvons encore sur le reste de ce même bandeau, au flanc de la tour. On y voit un cortège de voyageurs, les uns à pied, les autres à cheval, se suivant à intervalles réguliers; c'est peut-être le pèlerinage d'un noble qui voyage avec des serviteurs et des hommes d'armes. Dans le cortège on distingue aussi un quadrupède accroupi sur la selle d'un cheval : c'est probablement un guépard de chasse, luxe raffiné apporté d'Orient.
Les porches des deux portails latéraux, en saillie légère, sont très rapprochés du flanc des tours et sont rigoureusement symétriques entre eux : fronton triangulaire surmonté d'un acrotère, bordure de l'arc décoré de figures zoomorphes, colonnettes appuyées sur des figures stylophores elles-mêmes posées sur un haut socle. Symétrie ne veut pas dire identité. D'un portail à l'autre sont volontairement différents toutes les figures et tous les motifs décoratifs, de même que sont différents bien des éléments symétriques sur les deux côtés du portail lui-même. Le sculpteur médiéval se fait un point d'honneur de ne jamais se répéter servilement. Plus la ressemblance est grande, plus obstinée est la recherche d'un élément même minime de diversification. Il suffît d'observer les deux têtes de taureau sur la face antérieure des consoles de l'avant-corps septentrional : les deux taureaux semblent identiques à première vue, et cependant ils diffèrent dans la touffe de poils, plate pour l'un, frisée pour l'autre, dans la rosace au milieu du front et enfin dans les naseaux qui sur l'un sont plissés, sur l'autre non. Le porche septentrional est surmonté d'un acrotère qui représente un personnage en toge non identifié mais probablement très important, peut-être un empereur : à ses côtés se trouvent en effet deux hérauts qui sonnent la trompe. Son symétrique sur le porche méridional offre par contre une figure de mendiant encapuchonné qui s'appuie sur un bâton et porte sur le dos un fagot de bois. Kaimondinus vilis, dit la légende. Il s'agit de saint Raymond de Piacenza, un saint mystique du dangereux courant contestataire, pauvre protestataire, mort en 1200 et très vénéré dans le pays. La comparaison entre le personnage en toge et l'humble Raimondino confirme la répartition qualitative de ce qui se trouve à la droite et de ce qui se trouve à la gauche du Christ. La présence de Raimondino est par ailleurs un précieux indice chronologique qui appuie la date de 1202 considérée comme celle du commencement probable du chantier d'Antelami à Fidenza. Abaissant les regards de l'acrotère au fronton, nous trouvons sur le porche septentrional un bas-relief assez complexe, subdivisé en trois scènes que les légendes aident à interpréter. Au milieu, le pape Adrien II remet à l'archiprêtre de San Donnino la mitre et la crosse; ce sont les symboles de l'autorité épiscopale, mais il est improbable que Borgo ait eu dès ce moment-là le rang de diocèse. Il faut donc interpréter les symboles avec une certaine élasticité ; indices en tout cas d'une situation de prestige et d'autorité marqués pour l'église de Fidenza. A gauche est figuré sur son trône Charlemagne portant le sceptre et flanqué d'un écuyer qui lui tient l'épée. La tradition veut que Charlemagne ait élevé l'église de Borgo au rang d'« église impériale » : ce n'est sans doute qu'un reflet de cette tenace vocation gibeline qu'a toujours ressentie Borgo pour s'opposer à Parme. A droite enfin, une scène qui fait allusion à la réputation de thaumaturge attachée à l'église de Fidenza, grâce aux reliques du saint : un malade (egrotus, précise la légende) descend de cheval et entre à l'église pour demander la guérison. C'est un épisode que nous retrouverons au bandeau sculpté consacré à la vie du saint. Sur le porche méridional, la sculpture du fronton se limite à une figure d'évêque ou de prêtre mitre : probablement l'archiprêtre de Borgo San Donnino lui-même. Le bandeau décoratif bordant l'arc du porche septentrional (qui est tendu entre les deux têtes de taureau déjà signalées) est formé de douze losanges, six de chaque côté, avec des figures d'animaux réels ou imaginaires. Le même bandeau sur le porche méridional porte seize animaux, huit de chaque côté, renfermés chacun dans un élégant panneau encadré de feuillage; sur l'archivolte se tiennent, de dimensions plus grandes, deux griffons affrontés. Deux figures à demi cachées mais fort intéressantes (qui n'ont pas de correspondant sur l'autre portail) occupent l'intrados du même arc : l'une représente Hercule et le lion Némée, l'autre un griffon qui saisit un cerf, toutes deux reconnues comme des œuvres authentiques d'Antelami. Les figures stylophores qui supportent les colonnes des porches sont au Nord deux atlantes agenouillés, au Sud deux béliers. Ces quatre sculptures - étant donné leur position « à portée des enfants » - sont particulièrement abîmées. Les portails qui s'ouvrent sous les porches sont tous deux encadrés de faisceaux de colonnes et d'un arc à voussures multiples, et surmontés d'un tympan. Au tympan du portail Nord se trouve une Vierge à l'Enfant flanquée de deux groupes d'orants; à celui du portail Sud, la figure de saint Michel terrassant le dragon, entourée d'un large bandeau décoratif à rinceaux et feuillage. On voit à l'évidence l'intention du sculpteur de créer la diversité dans la symétrie et d'équilibrer les pleins et les vides : le bandeau décoratif compense la simplicité de la figure de saint Michel et n'a pas d'équivalent de l'autre côté où la représentation plus élaborée de la Vierge avec des orants remplit largement déjà le tympan. Si nous allons des extrémités vers le centre de la façade, nous rencontrons, après les portails latéraux, deux robustes demi-colonnes qui, coiffées de chapiteaux, se terminent à la ligne médiane de la façade. Il convient de mieux définir cette ligne médiane : elle se déploie à mi-hauteur du registre inférieur et le partage nettement en deux. A ce niveau s'alignent, mises en évidence par une légère frise d'oves, les impostes de la première division des tours et le bas des deux frontons des porches latéraux. Au centre, la ligne médiane sépare nettement la partie inférieure, dominée par les lignes verticales des colonnes et des faisceaux de colonnettes, de la partie supérieure où se trouvent les sculptures les plus élaborées : les chapiteaux des demi-colonnes, le long bandeau en bas relief avec l'histoire de saint Domnin, le très riche arc à voussures multiples du portail médian. Quant à la distribution en ombres et lumières des pleins et des vides, nous trouvons les arcs des portails latéraux au-dessous de cette ligne médiane, celui du portail central tout entier au-dessus. Dans le sens vertical, les demi-colonnes divisent la façade en trois parties presque égales et marquent à l'extérieur la division en trois nefs de l'intérieur. Pour cette raison, on peut juger vraisemblable l'hypothèse déjà mentionnée selon laquelle les demi-colonnes étaient destinées à se continuer sur toute la hauteur de la façade, comme à Piacenza. Demeurées tronquées, elles furent surmontées de statues, dont une fait défaut (on ne sait pas si elle s'est perdue ou n'a jamais été exécutée); il reste la statue de gauche, représentant l'apôtre Simon avec un phylactère. L'inscription Simon Apostolus eundi Romam Sanctus demonstrat banc mam témoigne de l'importance de Fidenza comme étape sur la route des pèlerins de Rome. A droite, où la statue fait défaut, on remarque l'absence de pierre de parement au-dessus du chapiteau, indice (mais non preuve) que les demi-colonnes étaient destinées à continuer vers le haut. Le chapiteau situé au-dessous de ce vide est de type corinthien à feuillage. Son lymétrique, qui supporte la statue de Simon, est beaucoup plus élaboré et orné de figures bibliques : sur le devant, Daniel dans la fosse aux lions; sur le côté, Habacuc guidé par l'ange porte sa nourriture à Daniel.
Nous voici arrivés maintenant au portail central, partie la plus spectaculaire où se concentre l'ensemble iconographique le plus complexe. Plus haut de deux marches que les portails latéraux, il est inclus dans un porche en saillie prononcée. Il a comme deux ailes sous la forme de deux niches abritant des statues de prophètes, et surmontées de bas-reliefs dont les thèmes se continuent à l'intérieur du porche; il faut donc les considérer - visuellement aussi bien que thématiquement - comme partie intégrante du portail lui-même. Le porche repose sur de belles colonnes de marbre rouge de Vérone, précieuse note de couleur qui se détache avec éclat sur le jaune de la pierre locale. Deux lions stylophores superbes, disposés sur de hauts socles, supportent les colonnes; celui de droite tient serré dans ses griffes un veau, celui de gauche un serpent. Ce sont des sculptures très semblables à celles à l'intérieur de la cathédrale de Parme, exécutées avec une égale maîtrise, et on les considère comme des œuvres authentiques d'Antelami. Les chapiteaux des deux colonnes portent des figurations complexes : scènes de la vie de Marie sur le chapiteau de gauche, les quatre évangélistes sur celui de droite. Ces derniers sont représentés (trois sur les quatre) d'une façon inhabituelle dans l'art roman : mi-homme, mi-animal, mêlant dans une seule figuration l'évangéliste et son symbole. Les deux consoles qui reçoivent la voûte du porche prennent appui d'un côté sur les chapiteaux décrits plus haut, de l'autre sur des atlantes pris dans le mur, personnages barbus et drapés dans leur vêtement. Deux motifs intéressants sont sculptés sur le devant des consoles, au-dessus des chapiteaux : à droite un diable cornu qui tourmente le prophète Job (allusion aux épreuves supportées par lui avec patience), à gauche le père Abraham. Trois petites têtes humaines sur les genoux du patriarche, dans les plis du manteau, représentent la progéniture nombreuse issue du « sein d'Abraham ». Les consoles ont des faces lisses, bordées dans le bas d'une moulure, dans le haut d'une corniche ; sauf sur le devant, elles ne présentent donc pas de sculpture; cependant leur hauteur détermine celle du bandeau en bas relief au-dessus de la ligne médiane, qui apparaît comme une suite géométrique de la console elle-même à l'extérieur et à l'intérieur du porche. Sur ce bandeau se déploie l'histoire illustrée la plus importante de la cathédrale : la série des récits concernant saint Domnin. Ce sont des sculptures pleines de vie, de mouvement et de force de persuasion, œuvres d'une main habile. On les considère comme œuvre d'un excellent élève d'Antelami (nous pourrions l'appeler « maître de saint Domnin »), où peut-être Antelami lui-même est intervenu. Elles sont réparties sur cinq panneaux, deux à l'extérieur du porche et trois à l'intérieur, avec les parenthèses des faces « muettes » des consoles. Analysons-les en détail, à partir de l'extrémité de gauche, après le chapiteau de Daniel entre les lions. Le premier panneau contient deux scènes distinctes. Dans l'une, Domnin couronne l'empereur Maximien, nous faisant ainsi savoir que le saint avait le rang de « cubiculaire » ou gardien de la couronne. L'autre semble une reprise de la précédente, avec les mêmes personnages; mais la légende vient à notre aide en nous expliquant que Domnin licentia accepta, Deo servire decrevit, c'est-à-dire qu'il décida de se mettre au service de Dieu avec la permission de l'empereur. Sur l'ébrasement de gauche du portail, au-dessus du faisceau de colonnettes et de piliers (huit en tout, sans chapiteaux) est disposé le second panneau qui représente la fuite de Domnin. La scène commence par une nouvelle réplique de Maximien, dans une attitude courroucée (la main qui se tient la barbe, signe de colère) et se poursuit avec le motif des fugitifs, Domnin et d'autres chrétiens fidèles à sa personne, qui s'éloignent derrière une colline. Le troisième panneau, qui occupe toute la longueur du linteau, est le plus vigoureux et le plus mouvementé, séquence cinématographique exprimée dans un langage concis et réduit à l'essentiel. Des tours d'une ville sortent deux cavaliers au galop, l'épée dégainée, qui poursuivent Domnin, lui aussi à cheval; le saint brandit une croix et un nimbe couronne sa tête. Après le passage de Piacenza (une autre tour où se montrent divers petits personnages avec l'inscription civitas Placentia) réapparaissent les poursuivants. Domnin est pris, et la scène suivante illustre son martyre sur les rives du Stirone. La figure centrale de la scène est le bourreau, vêtu d'une cotte de mailles, l'épée haute prête à tomber sur le cou de la victime; placée en diagonale par rapport aux épées des personnages précédents, cette lame dégainée est la note vibrante qui anime toute la composition, le cœur de toute l'histoire. Vient ensuite le martyr décapité, la tête coupée reposant sur un socle, puis à nouveau le martyr avec la tête dans ses bras qui se prépare à traverser le torrent Stirone (Sisterionis, précise la légende); au-dessus, deux anges en plein vol emportent la tête (c'est-à-dire l'âme) de Domnin au ciel. Avec le quatrième panneau (ébrasement de droite du portail, au-dessus des colonnettes qui ont ici de petits chapiteaux à feuillage) commencent les scènes des miracles du saint. Le corps de Domnin est étendu dans le sépulcre, sa tête entre ses mains. A l'église construite plus tard en cet endroit un malade se rend pour demander la guérison : c'est le même "aegrotus" déjà rencontré sur un bas-relief de la tour septentrionale, qui est arrivé à cheval et qui entre en se courbant avec peine dans l'église représentée aussi petite qu'une niche. En sortant guéri, le miraculé ne retrouve plus le cheval, volé par un brigand; mais alors intervient encore le saint thaumaturge, et le cheval échappant au brigand revient à son maître. Toute l'histoire est synthétisée en trois figures sur un fond d'arbres : Domnin gisant, Yaegrotus qui s'accroupit pour entrer dans l'église, le brigand qui retient le cheval, une main sur le museau, et s'accroche de l'autre à un arbre. Les légendes complètent le récit en expliquant : hic jacet corpus martyris, hic sanatur aegro-tus, hic restituitur equus. Le troisième et dernier panneau, à l'extérieur du porche, représente un autre miracle, bien plus tardif, et non dépourvu de vraisemblance historique : l'écroulement d'un pont sous le poids d'une grande foule, dont toutes les victimes sortirent indemnes, y compris une femme enceinte. C'est le pont sur le Stirone qui se trouvait devant l'église de San Donnino ...; l'écroulement se produisit à l'occasion de la redécouverte des reliques du saint dans la crypte de l'église, bien des siècles après le martyre, et de leur ostensión aux fidèles. Ce fut précisément le grand concours de peuple qui surchargea le pont et le fit céder. La scène est représentée de façon beaucoup plus élaborée que les précédentes, avec de nombreux personnages (dont la femme enceinte au centre) réunis en une seule composition, une tentative de perspective et une représentation soignée des détails, particulièrement dans les poutres du pont. Un large bandeau décoratif à rinceaux avec des fleurs, des feuillages et des grappes de raisin, élégamment dessiné et finement exécuté, typique du style d'Antelami, surmonte à l'extérieur du porche les bas-reliefs racontant la vie de saint Domnin. Au-dessus de ce bandeau se trouvent encore, des deux côtés, d'autres bas-reliefs figuratifs; mais leur disposition fortuite et désordonnée montre clairement que ce sont des fragments disparates provenant de la tour septentrionale (où le bandeau sculpté est mutilé, on l'a vu) ou bien d'ailleurs. Ils méritent quand même l'examen, car tous appartiennent à la même « génération » que les autres bas-reliefs, même s'ils ne sont pas tous de la main du « maître de saint Domnin ». A gauche, nous trouvons une Adoration des mages à laquelle fait suite immédiatement le songe de Joseph; à côté nous trouvons le curieux détail de deux corbeaux buvant dans un calice ; pas très facile à expliquer, c'est peut-être un simple divertissement du sculpteur. Ce panneau, par son thème, prend la suite des trois mages à cheval ; il semble donc naturel de supposer qu'il provient de la tour septentrionale. A droite le prophète Élie sur le char qui l'emporte au ciel ; au sol Elisée prie à genoux. La représentation du mouvement ascendant est intéressante : il est rendu par un plan incliné (comme l'aile d'un avion au décollage) sous les sabots des chevaux. Le vent de la course est marqué par la barbe du prophète rebroussée en arrière et par les rubans de sa coiffure qui voltigent. Un troisième panneau disparate se trouve dans le haut, du côté droit : c'est une composition carrée, encadrée d'une frise de grecques, qui représente le prophète Enoch au paradis. Revenons au niveau inférieur, pour examiner les deux « ailes » du portail, à savoir les niches des prophètes et les bas-reliefs qui les entourent. Les prophètes sont David à gauche (recon-naissable à sa couronne) et Ézéchiel à droite : deux superbes statues en ronde-bosse, la tête tournée vers la porte comme s'ils invitaient à entrer, portant deux phylactères qui tous deux développent le thème de la Porta Domini. Ce sont là les œuvres que l'on peut le plus sûrement considérer comme dues à Antelami lui-même. On regarde également comme d'authentiques sculptures du maître les quatre panneaux très élégants avec des animaux fantastiques à double forme, un de chaque côté des deux niches : griffon, capricorne, harpie, centaure. Tous les quatre sont formés des corps de deux animaux, allusion symbolique - dans l'esprit du Moyen Age - à la lutte entre le bien et le mal. Même le cul-de-four des deux niches est décoré de sculptures, au-dessus de la tête des prophètes : une Présentation de Jésus au temple au-dessus de David ; et au-dessus d'Ézéchiel une Vierge à l'Enfant entourée d'un arbre feuillu. Pour finir, les bas-reliefs à côté des niches (au-dessus des quatre panneaux d'Antelami avec des animaux fantastiques) représentent l'ultime invitation à pénétrer dans l'église. Deux anges, un de chaque côté, en indiquent la porte, et derrière eux viennent deux familles différentes de fidèles : pèlerins riches et élégamment vêtus d'un côté ; pèlerins pauvres de l'autre, avec des attributs de paysans. Ici encore se confirme la répartition symbolique déjà signalée : les puissants à la droite du Christ, les humbles à sa gauche. Le Christ-Juge siège sur un trône à l'archivolte du porche (un peu dans l'ombre, à cause du toit protecteur qui le surmonte). Vers lui montent deux files de petits personnages sculptés sur la bordure de l'arc : du côté gauche ce sont six prophètes en commençant par Moïse, qui tiennent en main autant de phylactères avec les commandements (Ancien Testament); du côté droit, se trouvent six apôtres, commençant par Pierre, avec des phylactères se rapportant aux Béatitudes (Nouveau Testament). Les prophètes portent une coiffure conique, les apôtres le nimbe. Les six figures de chaque côté forment en tout le nombre sacré de douze, mais elles n'épuisent pas tous les prophètes, ni tous les commandements, ni les apôtres. Il y a là une invitation à compléter les deux cortèges le long des deux impostes de la voûte du porche; mais nous n'y retrouvons que deux prophètes à gauche et un apôtre à droite. Dernier détail avant de quitter la façade : encastré dans la souche de la tour méridionale, nous trouvons un panneau isolé très abîmé, presque indéchiffrable. Il devait représenter le vol d'Alexandre le Grand avec deux chevaux ailés, légende médiévale d'origine obscure, qui reprend le thème de l'ascension au ciel déjà présenté par le bas-relief du prophète Élie. Plus bas est gravée l'ancienne mesure locale dite trabucco égale à 3 m 27. La façade, d'après les chroniques mesurait huit trabuccbi, soit 26 m 16, chiffre qui correspond avec une approximation honnête à la dimension réelle.
Des deux faces latérales, la face Sud donne sur la rue, tandis que la face Nord - moins intéressante - donne sur la cour de l'évêché. La face Sud est scandée de robustes contreforts, correspondant aux six travées des nefs latérales à l'intérieur. Toute la construction (murs gouttereaux, chapelles, clocher) est en brique : le parement en pierre est en effet réservé aux parties plus importantes, façade et abside. Aux quatre premières travées ont été ajoutées des chapelles d'époque postérieure parmi lesquelles se distingue particulièrement la quatrième, de la fin du XVe siècle, décorée en brique, ... Dans les deux dernières travées, on remarque les arcs brisés aveugles réalisés au cours de la dernière campagne de construction, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Dans la partie haute, au-dessus des chapelles et des arcades aveugles, se déploie une galerie d'arcades en plein cintre à colonnettes, couronnée sous l'égout du toit d'une frise d'arceaux entrecroisés. La même frise est reprise plus haut, terminant le mur extérieur de la nef centrale; cette seconde frise est cependant enrichie d'un bandeau en dents d'engrenage fait de briques mises en biais, procédé stylistique typiquement roman. Une observation minutieuse des chapiteaux des colonnettes a révélé un crescendo marqué dans la finesse de la facture lorsqu'on va de la façade vers l'abside, détail qui semble indiquer une évolution parallèle dans le temps : plusieurs décennies séparent les premiers chapiteaux des derniers. On trouve parmi ceux-ci des chapiteaux figuratifs pleins de vie : la sirène à double queue, un loup encapuchonné comme un moine, etc. La cathédrale, ..., n'a pas de transept. Le décrochement entre la face latérale et l'abside s'opère donc par l'intermédiaire du clocher, inséré entre la dernière travée de la nef et le mur extérieur du sanctuaire. Le clocher est du XVIe siècle, on l'a dit, mais d'après certaines observations architecturales, il semble avoir été construit à la place d'une tour romane préexistante. Le chevet révèle clairement l'implantation particulière de la cathédrale de Fidenza, .... Ce qui est singulier, c'est la profondeur du sanctuaire (dictée par les dimensions de la crypte, exceptionnellement longue), renforcée par l'absence du transept et par les terminaisons à mur droit des nefs latérales. Vue de l'extérieur, la nef centrale qui se prolonge dans le sanctuaire semble présenter un élan vertical anormal par rapport aux modèles romans; et l'abside semi-cylindrique, isolée, paraît tout aussi haute et élancée. Là où l'œil attendrait une autre abside semi-cylindrique pour terminer la nef latérale Sud par une surface courbe, nous trouvons à la place le prisme du clocher, avec ses arêtes nettes, et en plus son élan vertical. Cette impression de verticalité gothique, due à la solution architecturale adoptée, nous incite à dater l'abside des tout derniers temps de la période de construction de la cathédrale, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Cette impression se trouve confirmée par l'examen du parement de marbre qui manifeste - surtout dans la partie haute et dans le couronnement -un goût très marqué pour le décor. Voyons cela de plus près. Le demi-cylindre de l'abside présente à la base une plinthe très importante en hauteur comme en épaisseur, d'où s'élèvent quatre colonnes qui - recevant trois arcs aveugles en plein cintre - divisent l'abside en trois panneaux jusqu'à plus de la moitié de sa hauteur. Dans chacun de ces trois panneaux s'ouvre une fenêtre simple haute et étroite, encadrée de moulures multiples et flanquée de deux fines colonnettes. Au-dessus des trois arcs se poursuit la galerie d'arcades en plein cintre que nous avons déjà trouvée le long de la face Sud. Ici au chevet les arcades acquièrent une plus grande valeur tant par l'emploi de la pierre au lieu de la brique que par la présence d'éléments décoratifs supplémentaires, comme les rosaces ou autres frises dans les écoinçons des arcs (dont on peut soupçonner cependant que ce sont des adjonctions postérieures). Le bandeau terminal se révèle particulièrement élaboré : une frise d'arceaux entrelacés soutenus par des modillons à petites têtes d'animaux, un ruban en dents d'engrenage, et enfin un large cordon tressé qui fait le raccord avec la corniche de l'égout du toit. C'est peut-être ce dernier trait stylistique qui révèle le plus nettement l'arrivée de la sensibilité gothique au cours de la dernière phase de la construction. La sculpture d'Antelami nous réserve encore - après l'ensemble organisé de la façade -quelques épisodes savoureux, répartis de façon quasi clandestine sur l'abside. Il s'agit de quatre panneaux isolés provenant d'un ensemble dispersé des travaux des mois, et encastrés au hasard dans le mur : un au flanc du sanctuaire, à l'angle qu'il forme avec le clocher; un autre dans le contrefort qui divise le côté de l'abside, deux de part et d'autre de la fenêtre centrale de l'abside. A ceux-ci il faut ajouter, pour le plaisir d'être complet, un segment de frise encastré dans le bas du mur terminal de la nef latérale Sud, très abîmé et presque indéchiffrable, et un relief sur la plinthe de l'abside, dans la partie gauche, représentant un chien qui poursuit un cerf. Il faut accorder une attention particulière aux panneaux des travaux des mois, qui représentent une contribution supplémentaire à ce thème si cher à l'art roman : une page de plus, fragmentaire il est vrai, à comparer aux autres. Le premier panneau (selon l'ordre dans lequel nous les avons mentionnés) représente le mois de mai, sous la forme d'un cavalier avec lance et bouclier, surmonté du signe zodiacal des gémeaux. Ensuite, sur le contrefort, le mois d'août est représenté par une vierge (signe du zodiaque) en train de cueillir des fruits sur un arbre. Puis, à gauche de la fenêtre, mars et avril réunis sur un même panneau, sans signes du zodiaque : mars est un homme barbu sonnant de la trompe, avril une jeune fille avec un bouquet de fleurs. De l'autre côté de la fenêtre, janvier est peut-être la représentation la plus curieuse et la plus savoureuse. C'est un homme à deux têtes (Januarius, dérivé de Janus bifront) et trois jambes (l'une sans pied, repliée) qui se réchauffe au feu sur lequel bout une marmite; celle-ci pend au bout d'une chaîne à gros maillons attachée dans le haut à un bâton ; à celui-ci sont suspendues également trois saucisses mises à sécher. Où pouvaient se trouver à l'origine ces travaux des mois, il est difficile de le dire. L'hypothèse la plus acceptable est celle d'un portail de l'école d'Antelami sur la face Sud, démonté pour faire place à la construction des chapelles. ...
... L'intérieur de la cathédrale de Fidenza - à trois nefs, sans transept -se révèle sobre et sévère ; bien restauré (sentant peut-être un peu trop le neuf dans les maçonneries, les enduits et les marbres du pavement) et heureusement indemne de baroquisation, baldaquins et autres oripeaux. Le jeu de couleurs provient du rouge de la brique apparente, largement contrebalancé par le gris des piliers, des arcs, des colonnes et de l'enduit de la voûte. La nef centrale est divisée en trois travées rectangulaires par de forts piliers composés qui sur leur face interne se prolongent verticalement vers le haut le long des murs jusqu'à la retombée des croisées d'ogives. Trois paires de piliers secondaires - qui montent seulement jusqu'à l'imposte des grandes arcades - divisent en deux l'unité de base et doublent le nombre des travées dans les nefs latérales. Il y a donc six travées carrées par côté, prolongées vers l'extérieur par autant de chapelles qui, sur le flanc Nord, sont de faible profondeur, tandis qu'au Sud elles ont été agrandies (pour les quatre premières travées) par des remaniements des XVe et XVIe siècles. Les nefs latérales sont couvertes de voûtes d'arêtes sans nervures, séparées entre elles par des arcs transversaux en brique. Au-dessus, des deux côtés, se déploient les tribunes, couvertes en charpente apparente, qui donnent sur la nef par six baies quadruples à colonnettes. Prises sur l'épaisseur du mur sont dessinées six arcades en brique, correspondant aux grandes arcades du dessous, et d'égale ouverture; c'est dans chacune de ces arcades que s'insèrent les baies quadruples. Au-dessus des tribunes, les murs ont encore un troisième registre, divisé en trois par les piliers principaux; c'est là que sont situées les fenêtres (simples, six de chaque côté) qui éclairent la nef. Cette répartition de l'espace, et en particulier le trait des tribunes aux baies composées encadrées d'arcades épousant le rythme des grandes arcades, apparente étroitement la cathédrale de Fidenza à celle de Modène. ... Diverses caractéristiques architecturales, beaucoup plus tardives, se rencontrent dans le sanctuaire et en particulier dans le cul-de-four de l'abside; mais la différence la plus évidente vient des voûtes en croisées d'ogives de la nef centrale qui ont probablement remplacé une couverture en bois à charpente apparente dans l'église de 1106 et furent réalisées dans la seconde moitié bien entamée du XIIIe siècle. La largeur de la nef centrale va nettement en diminuant de l'entrée au sanctuaire, passant de 10m50 à 8m 90: c'est un artifice de perspective voulu, qui augmente l'effet de profondeur. Le sanctuaire est notablement surélevé; on y accède par trois escaliers, l'un au milieu de la nef (qui commence à la fin de la deuxième travée) et deux latéraux perpendiculaires au premier. Aux côtés de l'escalier central descendent les deux escaliers qui mènent à la crypte. Le sanctuaire (et la crypte au-dessous) a une longueur d'environ 18 m; en y ajoutant l'escalier, on arrive à 23 m 40, chiffre égal à la moitié de la longueur interne totale de l'église (47 m). La crypte est divisée par des colonnettes en trois nefs de six travées chacune. Le décor sculpté à l'intérieur de la cathédrale se compose des chapiteaux des piliers, de ceux des colonnettes des tribunes, des bas-reliefs sur l'arrondi de l'abside et d'un remarquable bénitier. ...
(extrait de : Emilie romane ; Sergio Stocchi, Ed. Zodiaque, Coll. La nuit des Temps, 1984, pp. 83-97)
Coordonnées GPS : N44.8665 ; E10.057725
2025 All Rights Reserved wallpaper hd evening.
